MEGAFORCE (1982)
(1982)
MEGAFORCE
Compositeur : Jerrold Immel
Durée : 41:48 | 16 pistes
Éditeur : BSX Records
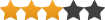
« Les bons gagnent toujours. Même dans les années 80. » Surtout dans les années 80, brûle-t-on de rectifier cette maxime goguenarde. Avec son brushing troué d’un bandana fluo, sa combinaison toute collante de lycra et son sourire jailli d’un spot publicitaire pour dentifrice, l’auteur dudit adage est lui-même le portrait craché d’une nouvelle génération de héros hollywoodiens, enfantés par le désir presque puéril d’en finir une bonne fois avec l’ambivalence de la décennie précédente. Voici donc venir à la rescousse Ace Hunter, le sémillant professeur d’aérobic suscité, et sa clique de sauveurs auto-proclamés de la démocratie, mise en péril aux quatre coins du monde (ou comme ici, dans la fictive Galibie) par l’engeance bolchévique. On croirait être tombé tête la première dans le bac à sable tenant lieu de quartier général aux super-soldats de G.I. Joe, ou faire face à une version de Team America expurgée du moindre sarcasme à l’encontre de la bannière étoilée. Le four cuisant essuyé par MegaForce n’en apparaissait que plus inéluctable encore — à titre rétrospectif seulement, si l’on se réfère aux confortables sommes d’argent qu’une production cosmopolite, dont la fameuse Golden Harvest de Hong Kong, injecta dans cet hymne obèse à l’oncle Sam. Des monticules de billets imprudemment investis, le film donne par ailleurs le sentiment d’en avoir dilapidé l’essentiel à la roulette, écartelé qu’il est entre les décors pansus d’une base secrète que James Bond eût adoubée d’un claquement de langue appréciateur, et une esthétique drapée des tristes guenilles du post-nuke italien. En sus, un diagnostic rigoureusement similaire s’impose à la partition de Jerrold Immel. Nanti d’un orchestre suffisamment costaud pour lustrer les batailles entre tanks et motos futuristes avec toute la pompe solennelle idoine, le compositeur choisit pourtant de régulièrement le snober au profit d’hippopotamesques synthétiseurs. L’ode militariste titube, grince, n’expulsant plus, en fait de cuivres de tonnerre, que les flatulences stériles d’un patriotisme en toc.
Furoncle bis d’un côté, machine à sympathiquement guerroyer de l’autre. Accoutumé de longue date aux privations spartiates de la petite lucarne, Jerrold Immel se découvre enclin à s’octroyer ce que lui-même devait considérer sans doute comme un caprice digne d’une diva : à savoir, recourir aux formes oblongues et des plus imposantes (quatre mètres de long !) du Blaster Beam, singulier instrument créé par le musicien Craig Huxley. Trois ans auparavant, la bête faisait sensation en emplissant l’espace infini de Star Trek: The Motion Picture (Star Trek : le Film), puis de Meteor aussitôt après, de ses coassements caverneux, matérialisation à frémir d’une terrifiante menace jaillie des tréfonds des étoiles. Cette fois, le danger se révèle terrestre, par comparaison presque banal. Même à la tête d’une armée cuirassée, le mercenaire incarné par un Henry Silva aux abonnés absents, débonnaire dans sa panoplie de bandido de quat’sous, pourrait aussi bien avoir été téléporté en chair et en os d’une planche d’Hergé. Et quand les spectateurs découvrent, tout secoués de rires, que l’inimitié qui l’oppose à Ace Hunter découle entière d’une sombre histoire de briquet chapardé… Afin de revaloriser son crédit loqueteux et donner un brin de ressort à son cigare en berne, le chef des soudards s’en remet donc, en désespoir de cause, à un ostinato électronique récurrent, compagnon grossièrement équarri du Blaster Beam. En filigrane, les véloces saccades des trombones rappellent à toutes fins utiles que, derrière les ornières synthétiques qui font bringuebaler, il y a tout de même du métier. Malgré les airs éhontés de campagne de recrutement pour l’US Army qu’elles aiment à se donner, les multiples fanfares jalonnant MegaForce se roulent surtout dans une allégresse pop qui ne déparerait point les génériques des TV shows Voyagers ! (Voyages au Bout du Temps) et Dallas, deux frétillants témoignages du modeste mais réel brio de Jerrold Immel. Seul, le bouquet final tente de se soustraire à cette règle bariolée, en emmitouflant son Love Theme melliflu d’orchestrations ouvrées avec soin. Les cuivres, enfin soucieux d’autre chose que de trompeter d’importance, ainsi qu’un hautbois tendre plutôt que sirupeux, attestent dans un bel ensemble aux mécréants pétris de doutes que le pyjama disco d’Ace Hunter abrite un cœur d’artichaut.
À aucun moment, l’auteur des présentes lignes n’aura partagé ce peu glorieux scepticisme ! Il n’est que de considérer l’inénarrable séquence du saut en parachute, durant laquelle notre héros, à force de cabrioles antigravitationnelles, ensorcelle sa ravissante collaboratrice. Et pendant que des transparences on ne peut mieux nommées s’évertuent par leurs fourbes assauts à laminer la dignité des deux comédiens, le spectre acidulé de Knots Landing (Côte Ouest), l’autre mastodonte du soap opera tombé jadis dans l’escarcelle d’Immel, réussit à engendrer l’illusion que le couple de tourtereaux convole en juste noces. Mais l’impérieuse nécessité de châtier l’injustice où qu’elle soit met vite un terme à cet à-côté ivre de boîtes à rythme — la sauvegarde du monde, après tout, demeure un truc de mecs. Retour immédiat, donc, à la bravoure fournie en quintaux dodus par l’orchestre zébré de coutures proéminentes. La dernière partie du film tourne pour de bon au capharnaüm militaire, avec un raid nocturne vrombissant où les motards de la liberté bombardent à hue et à dia, peu avant que les derniers dollars de budget ne s’évanouissent en fumée… ou plus exactement en fumigènes, vomis dans le sillage des deux-roues pour dérober le champ de bataille aux yeux effarés du spectateur. À celui-ci de se débrouiller afin de savoir qui canarde quoi ! Ce n’est pas l’affaire de Jerrold Immel, dont la fringale d’expérimentations électroacoustiques voisine ici avec la boulimie. Dans ce qui s’apparente à un baroud d’honneur crinière au vent, il tente jusqu’à plus soif, fait se télescoper martèlements hachés de caisse claire et batterie exaltée, héroïsme tous biceps dehors et froideur gercée, mais, étonnamment, garde un semblant de cap. Il le tient même d’une poigne assez ferme pour survivre au sidérant « clou » du spectacle, l’envol indescriptible de la super-bécane d’Hunter, partant à l’abordage des cieux sur un coussin de cuivres rodomonts et de spasmes synthétiques d’un autre âge. Rien que cette gâterie-là prédestinait MegaForce, film et musique confondus, à tomber un jour entre les griffes de Buysoundtrax, éditeur lépreux qui ne s’émeut qu’aux arômes pénétrants du bis. L’album né de cette rencontre s’achève par un court extrait donnant à entendre Ace en personne, porteur de la morale de l’histoire qui a valeur aussi d’universelle vérité. Elle figure en exergue de cet article, et pourrait être formulée d’une manière plus éloquente encore : « America, fuck yeah ! »










