 THE PROTECTOR (1985)
THE PROTECTOR (1985)
LE RETOUR DU CHINOIS
Compositeur : Ken Thorne
Durée : 45:55 | 13 pistes
Éditeur : Dragon’s Domain Records
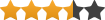
Les images liminaires de The Protector ont le don de déconcerter. Au coeur d’une nuit enfumée de brouillard, des immeubles à la mine rébarbative menacent ruine. Des silhouettes hautes en couleur, iroquois friands de cuir et nains travestis en bérets verts (!!), serpentent parmi les feux de poubelle, manifestement à l’affût d’un coup de Jarnac. Le bisseux aguerri exultera, croyant identifier dans ces oripeaux loqueteux les stigmates du post-Nuke, synthétiseurs impécunieux inclus — lesquels, à vue d’oreille, pourraient aussi bien avoir pour géniteurs les frères De Angelis, ou tout autre baroudeur aux semelles élimées des terrains vagues dont sont jonchées les apocalypses de seconde zone. Un petit détail cloche néanmoins au milieu de ce fatras d’extrapolations : que vient fiche en haut du générique le nom de Jackie Chan ? On peine à imaginer le chantre du divertissement bon enfant donner soudain la chasse à des punks sadiques… Et en effet, la suite le ramène presto dans le cadre moins tourneboulant du polar urbain ; l’aire de jeu idéale, Chan s’était-il autorisé à croire, et la formule miracle qui transformerait l’humiliante débâcle de ses premières tentatives de percée américaine, cinq ans auparavant, en couronnement nimbé du vert des dollars. Alors il y met du sien, allant jusqu’à taillader son sacro-saint code moral en jurant (hérésie !), en criblant de balles des petites frappes (est-ce possible ?) et même en prenant du bon temps entre les mains graciles de masseuses dont rien ne dérobe la vertu aux yeux torves (sacrilège !). Au bout de quelques bobines seulement, voici la star devenue bon gré mal gré une sorte de « Dirty Jackie », tout juste plus souriant que son modèle sculpté dans le granit. Lalo Schifrin eût couché entre ces deux-là le trait d’union parfait, d’autant que le jefe argentin avait déjà fait goûter le gnome casse-cou à sa vertueuse médecine dans The Big Brawl (Le Chinois), joyeux histrion musical et régalade chaloupée. Mais cette fois, le compositeur n’était pas du voyage, non plus que sa revigorante fantaisie. Les années 80 tambourinaient à la porte, inutile de les faire lanterner en se piquant d’artistes fioritures.
C’est à Ken Thorne qu’échut finalement le rôle du cicérone ouvrant le battant — un choix par défaut, pourraient supputer les langues de vipère. Le vétéran britannique, fraîchement sexagénaire au moment des faits, voyait déjà s’émousser le petit prestige des itérations « williamsiennes » qu’il écrivit pour les suites de Superman, son crédit le plus notoire, mais pas le mieux représentatif d’une carrière protéiforme. Il restait alors sur la partition sèche comme un coup de trique de The Evil that Men Do (L’Enfer de la Violence), l’un des rares Charles Bronson de cette décennie à peu près fréquentables, dans la lancée duquel le compositeur escomptait peut-être poursuivre. Si ça n’avait tenu qu’à James Glickenhaus, qui ne fit jamais mystère de sa solide résolution à mâchurer l’image quasi-virginale de Jackie Chan, un blanc-seing lui eût sans doute été volontiers accordé. Sauf que le principal concerné ne tarda pas à faire machine arrière, comme si ses propres audaces l’avaient laissé pantelant d’effroi. Une volte-face qui ne fut pas sans répercussion sur le Main Title, contraint à un numéro incertain de funambulisme entre l’âpreté hard-boiled rêvée dès l’origine et un ton à la cool, plus en phase avec le slapstick choyé par Jackie l’amuseur public. Le résultat, un rien schizophrène, convainc étonnamment, toujours sur le fil de ses lignes de basse hérissées mais tirant sa fruste énergie de la friction des contraires. À la remorque de notre héros, les cuivres pataugent au milieu des ordures du New York craspec d’avant la tolérance zéro, mais en sortent par miracle immaculés. Pareillement, la guitare électrique se délecte à faire de ce thème aussi souple que du caoutchouc son quatre heures, en une cataracte de riffs qui soulèvent l’image d’un sourire insolent plutôt que d’un rictus trop carnassier. Au bout d’à peine un tiers de métrage, quand le script, en un désarmant aveu d’échec, réexpédie Chan au bercail, l’inhospitalière Hong Kong où l’attendent les barons de la pègre et sa troupe d’intrépides cascadeurs, le thème renonce à ses velléités hargneuses pour se vêtir des couleurs locales autrement pittoresques. Il n’en ressort pas châtré pour autant, et prouve a contrario, tous glissandi exotiques dehors, qu’une malléabilité d’excellent aloi compte parmi les nombreuses cordes dont il dispose à son arc.
Si Ken Thorne peut se flatter de l’épiderme changeant du caméléon, l’arrangeur-bidouilleur Rick Marvin, son partenaire de très ancienne date et grand ami, n’est de son côté pas en reste. Durant la séquence suscitée du salon de « relaxation » que Jackie et un Danny Aiello frétillant visitent dans l’idée de se (dé)tendre, il bricole une source music maculée des giclures électroniques d’un Orient pour dépliant touristique, avant de bifurquer vers un saxophone au déhanché fripon. Mal lui en prit ! Ces minauderies dignes des chichis du cinéma rose de l’époque n’eurent pas l’heur de séduire en haut lieu, où l’on résolut de de leur substituer les violonades suprêmement charmantes du Shanghai Blues de James Wong. Il suffit pourtant de faire s’entrechoquer ces antagonistes front contre front pour constater que Marvin avait trouvé le ton idoine, gentiment vulgaire… L’entité bicéphale qu’il forme avec Thorne crache cependant de jolies flammes dès l’instant suivant, lorsque les doigts fuselés des gourgandines s’emparent de couteaux prêts à mordre. Les rots qu’éructent les cuivres et les impromptus en dents de scie des synthés font l’ossature d’un de ces melting pots tels que les eighties en hébergèrent par centaines ; mais le marimba, porté par un étincelant ostinato, dote l’ensemble d’un lustre inespéré. De ces finesses percussives, n’espérez en revanche point relever la moindre empreinte dans l’affrontement final, qui joue ouvertement la carte d’une surenchère rock ‘n’ roll. La guitare électrique, à force de braillements sans complexe, en vient à disputer la vedette à Jackie en personne, si bien qu’il faut envisager la plausible irritation de ce dernier dans l’éviction in fine dudit morceau. Échaudé au-delà de tout par ce qu’il estimait être des outrages à son image de marque, l’empereur de Hong Kong remodela The Protector pour le marché asiatique, émorfilant son montage, liquidant le maximum de gros mots, déclarant la guerre aux mamelons baladeurs. La prochaine fois, se jura-t-il, aucune incartade similaire ne serait tolérée. Et en effet, Rush Hour, treize ans plus tard, sonnait comme une très pantouflarde apologie du système Jackie Chan — et lui livrait surtout, enfin, les clefs d’Hollywood convoitées une éternité durant. Lalo Schifrin était de retour, presque comme une forme d’évidence, dans le rôle du bon génie ayant gardé par-devers lui les formules magiques des seventies. Une autre forme de célébration, après les années 80 auxquelles Ken Thorne fit un gringue endiablé.











