 THE RED CANVAS (2009)
THE RED CANVAS (2009)
THE RED CANVAS
Compositeur : James Peterson
Durée : 44:31 | 18 pistes
Éditeur : MovieScore Media
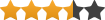
Il y aurait là presque matière à l’un de ces récits estampillés rise and fall dont on raffole tant outre-Atlantique. Sorti de nulle part, n’ayant en guise de carte de visite qu’un petit fagot de courts-métrages, James Peterson affichait le profil vierge d’aspérités de simple chair à canon pour une industrie vorace, qui réclame toujours plus de notes consanguines sur le papier à musique. The Red Canvas, vers lequel le hasard téléguida notre jeune compositeur, étant par surcroît un ixième avatar du cinéma de cogne à l’américaine, a priori condamné d’office à mijoter parmi les riffs rances d’un sound design emplâtré de simili-rock, la messe paraissait déjà dite. Au lieu de quoi, le chien fou Peterson, en pleine euphorie, délivra rien de moins que la plus opulente partition symphonique qu’ait connue le film d’action à mains nues depuis le formidable Lionheart (Full Contact) de John Scott. De quoi faire tourner la tête du béophile vieux jeu, chez qui les épaisses ficelles électro garrottant les divertissements modernes n’engendrent qu’une morne répugnance, et porter à ses lèvres moult comparaisons avec les feux « péplumesques » de Miklós Rózsa… Bref, un mets de choix pour MovieScore Media, le label des sans-grades et des outsiders de bonne volonté. Son ancien renom, parti depuis en lambeaux, tira ample profit de compositeurs souvent inconnus au bataillons mais résolus à faire parler la poudre, fût-ce à tort et à travers.
Sachons tête froide garder. S’il ne s’ébroue pas sous le bruyant patronage de Zimmer et consorts, Peterson n’a pas pour autant course gagnée auprès des oreilles nostalgiques des misteriosos sublimes et des fanfares que Rózsa savait comme personne charger de tumulte. Le titan hongrois, dont la fièvre romantique marqua le point culminant d’une certaine idée (fort peu discrète !) du Golden Age hollywoodien, ne projette qu’une ombre morcelée, zébrée d’entailles, sur l’écriture en comparaison bien schématique de son soi-disant dauphin. Au paroxysme de sa fureur, pourtant, The Red Canvas fait mieux qu’offrir un fugace entraperçu des ombres majestueuses de jadis. Son prélude ressemble à une profession de foi, tout empourprée de cuivres qui scandent une marche de fer et de feu. Le message est clair : dans les arènes pleines à craquer de l’UFC s’affrontent les nouveaux gladiateurs. Dépossédés de leurs casques à cimier, n’ayant plus ni glaive ni trident pour en découdre, certes, mais est-ce une raison suffisante pour jalouser leurs lointains ancêtres dans la distribution de horions ? L’écoulement des ans, à dire vrai, les a surtout affligés des stroboscopiques scories d’une esthétique MTV : on reste coi face aux dégâts causés par une mise en scène plus imbibée qu’une éponge, qui s’acharne contre toute raison à saboter le vérisme brut de décoffrage des corps-à-corps. Bon courage pour différencier les coudes foudroyants des genoux-éclairs, et ne parlons même pas d’identifier les mâchoires prognathes sur leurs trajectoires… À l’autre bout du spectre, sans lien, jurerait-on, avec cet étal de boursouflures m’as-tu-vu, Peterson met les bouchées doubles à la poursuite du noble film d’action qui paraît avoir germé sous son crâne.
Une escarmouche dans un garage lui offre de se faire d’abord la main. Le résultat, savante cacophonie, cherchant moins l’épate à peu de frais qu’un impact exigeant, donne à admirer la technique étonnamment achevée dont jouit l’imposant pupitre des cuivres. Les trombones s’étranglent en quintes spectaculaires, les trompettistes arrachent de leurs lèvres bientôt tuméfiées des cyclones à la lisière parfois de l’avant-gardisme… Et ce n’est là qu’un amuse-gueule. Pourtant, quand vient l’ultime combat à l’issue duquel se jouera le sort du héros affamé de rédemption, le soufflé semble presque être retombé, à moitié occis par des essais dramatiques frigides et par des musiques additionnelles sur lesquelles les poncifs électro-rocks règnent en seigneurs adipeux. La coda espérée malgré tout ne se révèle que plus dévastatrice. Près de douze minutes durant, l’orchestre (qui fut, pour la petite histoire, mis sur pied par le compositeur lui-même) libère d’ébouriffants flots d’énergie, d’où la parenté avec le péplum émerge plus orgueilleuse que jamais. Le monolithisme de ce pinacle, qui n’offre à ses dantesques scansions que le contrepoids d’éphémères bouffées d’émotion, devient même un atout maître, source d’adrénaline en geyser plutôt que de lassitude. Voir ainsi pourfendue la moindre parcelle de demi-mesure a quelque chose de profondément euphorisant, et le triomphe final du bagarreur vedette, à genoux, les bras levés haut pour recueillir l’adoration de la foule transie, entre en résonance avec celui de Peterson. Las ! Au baptême secoué de rage succéda immédiatement l’extrême-onction — car, hormis d’éparses bafouilles, le jeune compositeur disparut du jour au lendemain de la circulation, victime, on l’imagine, de l’éternelle sélection naturelle. The Red Canvas, ou la vie et la mort mêlées en un élan indivisible de l’étoile filante James Peterson.










