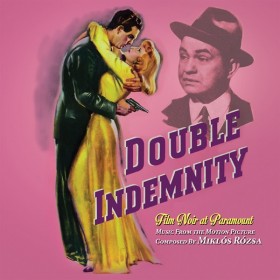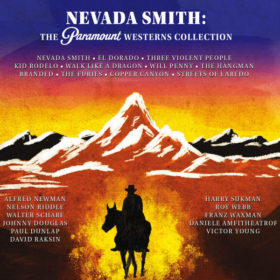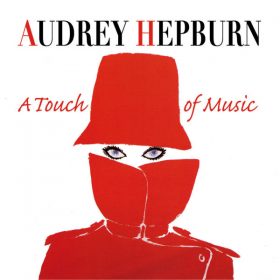OBJECTIVE, BURMA! (1945)
OBJECTIVE, BURMA! (1945)
AVENTURES EN BIRMANIE
Compositeur : Franz Waxman
Durée : 71:34 | 13 pistes
Éditeur : Marco Polo

Hardi, un coup de collier ! Début 1945, le capiteux fumet de la victoire finale, chaque jour un peu plus proche, grisait les forces alliées. Loin de la ligne de front, on humait aussi l’enivrant parfum, exhortant les propagandes de tous bords à redoubler d’efforts. Au premier rang de celles-ci, il y avait évidemment l’Oncle Sam et ses chantres par légions. Le mauvais papier des comic books s’embrasait des exploits de Captain America, nouveau champion de la bannière étoilée, qui bottait à n’en plus finir l’arrière-train d’un Hitler amenuisé au stade de bad guy d’opérette. Bourdonnante d’activité sur les collines d’Hollywood, l’usine à rêves ne régurgitait plus seulement de bienheureuses chimères mais des héros prêts à l’emploi, dont rien, et certainement pas la menace des Fritz et des Japs, n’était capable d’éborgner la vaillance. Des soldats tel que celui interprété par Errol Flynn dans Objective, Burma!, par exemple. Pensez donc ! Le prince canaille du swashbuckler, téléporté en pleine campagne de Birmanie pour flanquer une déculottée à l’armée d’Hirohito, tandis qu’éclate et roule, irrésistiblement cuivrée, une fanfare à forte teneur chevaleresque — non plus l’œuvre cette fois d’Erich Wolfgang Korngold, mais de son non moins éminent homologue Franz Waxman. Tous les ingrédients d’un cocktail à la gloire exclusive de l’Amérique, tant et si bien que les Anglais, fer de lance des combats dans le pays aux mille pagodes, s’offusquèrent tout haut d’en avoir été bannis.
C’était mal connaître cette grande gueule devant l’Éternel de Raoul Walsh, cependant, que d’attendre de sa part un simple produit au garde-à-vous. Un film d’hommes, certes oui, comme son curriculum vitae en regorge, mais une vitrine de luxe pour l’US Army ? Que Pierre Schoendorffer, avec La 317ème Section, ait à peu de choses près fixé son pas sur celui du borgne indomptable devrait suffire à vous renseigner. Rapidement, le vrai projet de Walsh prend corps, lorsque Flynn et son bataillon de parachutistes attendent qu’on les largue en territoire ennemi. Aussi serrés que des harengs dans la carlingue de l’avion, les soldats inondés de sueur rongent leur frein comme ils peuvent, en fumant, en lisant, en priant. Waxman le sait, en fin observateur qu’il est : rien n’eût semblé plus hors de propos que de gratifier d’une déflagration d’héroïsme réchauffé ces bougres mijotant aux degrés divers de l’attente. L’un d’eux notamment paraît à deux doigts de flancher, et c’est autour de ses mains tremblantes, de la lueur hagarde au fond de ses yeux, que la musique se cristallise, presque en sourdine ; une vraie petite boule de stress, réminiscence tourmentée d’un Bartók ou d’un Charles Ives (et dont James Horner et Jerry Goldsmith se souvinrent à leur tour, beaucoup plus tard, dans les années 80). Même le fameux saut dans le vide, à cent lieues d’une quelconque catharsis cuirassée de trompettes, triture encore ce sentiment de peur, le lacère, serait-il mieux approprié de dire, les archets des violons frappant sans relâche d’estoc. Sous leurs piqûres frénétiques, les parachutes qui fleurissent selon un ordre serré perdent toute superbe, pour ressembler davantage à une nuée d’oiseaux effarouchés.
Une fois au sol, une autre forme d’angoisse commence. Le fabuleux chef-opérateur James Wong Howe s’enfonce aux confins du fantastique, dans cette jungle tantôt striée d’ombres qu’il crible d’une vie inquiétante, tantôt cuite et recuite par la fournaise du soleil. Elle a beau leur servir de moteur, la marche militaire centrale progresse à l’instar des G.I.’s, en tapinois seulement, quitte à se camoufler sous le timide murmure d’une flûte ; en bref, économe du moindre tapage susceptible de donner l’alerte. Désormais sur un pied d’égalité, les pupitres de l’orchestre s’échinent à rivaliser de touffeur avec le dédale de l’enfer vert, bois chuchotants, cordes qui se font les émissaires d’un danger larvé, le tout ponctué d’épisodiques hoquets de cuivres, la plupart étouffés sitôt émis. Pas le choix : des forces invisibles rôdent, sans visage, sans estampille musicale non plus. L’ouverture, qui dévoue ses mesures initiales à un orientalisme déjà cliché, même à cette époque, augurait pourtant d’abondantes références au péril jaune. Il n’en sera finalement rien. Peut-être Waxman, en osmose avec la mise en scène au cordeau de Raoul Walsh, souhaitait-il gommer autant que possible l’identité nippone des assaillants dans l’espoir qu’en résulterait une menace accrue, voire une présence maléfique, quasiment abstraite dans son intangibilité. Les germes du futur Predator sont indiscutablement en terre ! Ceux de la partition d’Alan Silvestri également, d’une certaine façon, cette dernière semblant faire siennes parfois les hachures énergiques dont Waxman griffe le papier à musique.
Quand l’opportunité se présente de jaillir entier de sa coquille, l’hymne martial la saisit avec l’incoercible vigueur d’un geyser de vapeur, comme pour conjurer la pression par trop souveraine. C’est l’heure des ruées au pas de charge et des escarmouches fertiles en douilles brûlantes, où cors et trombones font résonner à satiété leurs exclamations belliqueuses, au point que les Japonais eux-mêmes en tirent quelque bénéfice guerrier. Le terrible affrontement final, au sommet d’une colline pelée, se mue ainsi en un siège mortel, mené par Walsh tambour battant — ça n’est pas là une expression en l’air, eu égard aux caisses claires qui imposent un mitraillage nourri. Revigoré, plein d’orgueil, le thème principal domine la mêlée jusqu’au sauvetage aérien du commando de braves, précédant un point final auquel Waxman insuffle bien volontiers le triomphalisme requis. Une manière égale à d’autres, tout bien soupesé, de mettre la dernière main à l’une des plus efficaces musiques de son formidable corpus… Dans l’intervalle, Walsh sera parvenu à filmer la scène qui, à ses yeux, incarne la seule conclusion possible : le moment où Errol Flynn, après avoir écouté sans mot dire le haut commandement l’abreuver de félicitations, exhibe pour toute réponse un chapelet de plaques d’identification. Vestiges dérisoires des hommes fauchés par la guerre, qu’effleure ainsi qu’une brise moribonde le fantôme de la fameuse sonnerie aux morts de Daniel Butterfield.