 DEMENTIA (1955)
DEMENTIA (1955)
DEMENTIA
Compositeur : George Antheil
Durée : 47:53 | 5 pistes
Éditeur : Kritzerland Records
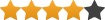
Une ville, la nuit, familière et pourtant si hachurée d’angoisse. Une femme erre dans son inextricable labyrinthe comme au sein d’une chimère délétère. Ses talons claquent sur un tempo affolé, elle jette par-dessus son épaule des regards éperdus… et toujours surgit dans son sillage une inquiétante silhouette, celle d’un homme en apparence, peut-être un revenant démoniaque, dont rien ne semble en mesure d’ébrécher le sourire lourd de promesses… Vous avez dit Carnival Of Souls ? Appréciable tentative, mais il vous faudra remonter un peu plus encore le cours du temps pour réussir à identifier le titre-mystère : Dementia. Les deux films ont sans conteste en commun cette ouate d’un noir d’encre, lambeau déchiqueté de l’étoffe dont on fabrique les cauchemars et que l’héroïne s’échine en vain à griffer, prisonnière de ses replis. Tous deux aussi, passés en catimini dans les drive-in et les successeurs des Nickelodeon, faillirent disparaître corps et biens avant que des cicérones de prestige, doublés d’hommes de goût, ne leur ouvrent les portes d’une re(con)naissance du meilleur aloi — tempérée, malgré tout, par le goût de cendres que laissent fatalement les a posteriori surgis trop tard. Quelle carrière eussent connu Herk Harvey et John Parker, maîtres des abîmes et des ténèbres, cinéastes mort-nés, si un franc succès avait couronné aussitôt leur premier effort ? Et ce diable de George Antheil, provocateur, intenable, serait-il devenu une figure d’importance des salles obscures ?
N’allez point en hâte extrapoler. Le compositeur, surnommé de son vivant le « bad boy » de la musique, n’est en rien l’archétype de l’artiste maudit et condamné à n’être louangé que dans des circonstances nécrologiques. Avec l’illustre Ballet Mécanique comme tête de gondole couverte indifféremment d’éloges et d’opprobre, son œuvre pour la scène classique tangue entre expérimentations sonores dignes d’un laborantin et renoncements la mort dans l’âme, et connut assez de fortunes en tous genres pour remplir deux ou trois carrières plus ordinaires. Mais dans ce corpus chaotique, le cinéma a toutes les allures du parent pauvre. Il y eut bien quelques rencontres prestigieuses, à commencer par Fritz Lang sur House By The River, sans que la filmographie d’Antheil n’ait cependant joui du projet-torpille qui l’eût nimbée d’un prestige nouveau. Peu à peu désabusé au fil des ans, aigri peut-être, le compositeur ne vit bientôt plus dans le grand écran qu’un vil expédient tout juste bon à faire bouillir la marmite. A lui seul, pourtant, Dementia balaie d’une chiquenaude l’amère sentence. Il n’y a là aucune des facilités coutumières aux vulgaires besognes de vendu, pas l’ombre d’un de ces frissons de pacotille chargés de soutirer quelques gloussements à ceux quémandant du fantastique bas de plafond. A film pas banal, partition ad hoc.
Et, dans le même cheminement d’idées, à comédienne charnelle et habitée, soprano d’obsédante envergure. Adrienne Barrett, catapultée sans transition du secrétariat de John Parker au plateau de tournage plongé par celui-ci au creux d’ombres voraces, interprète la Gamine, une femme dont on a tôt fait de nourrir de soupçonneuses conjectures quant à l’équilibre mental. Cette psyché en pleine débâcle, qu’un traitement plus terre à terre aurait changé à coup sûr en une caricaturale séance sur le divan, se cristallise dans tout son envoûtant mystère grâce aux ululements de Marni Nixon, « the best known of the ghost singers », pour paraphraser le Los Angeles Times, qui parlait d’or. Alors au seuil de la drôle de consécration « fantôme » que devaient lui apporter les chants de The King And I (Le Roi et Moi) puis d’An Affair To Remember (Elle et Lui), l’artiste s’immerge dans cette fantasmagorie avec une jubilation d’autant plus accrue que la piste sonore, ayant cousu les lèvres de l’ensemble des protagonistes pour n’en laisser filtrer ici et là qu’une poignée de rires et de cris, livre le film pieds et poings liés à ses fascinantes vocalises — le genre d’aubaine que le cinéma ne condescend qu’à titre exceptionnel à offrir.
Et la grande dame de se lancer à larynx perdu dans un oratorio d’outre-tombe, où la gamme des aigus frémit, se tord et se convulse comme victime des attaques spectrales d’un thérémine. Ses complaintes inlassablement répétées ont tôt fait de charbonner les sept notes d’un thème sournois, étrange feu follet perdu au sein de l’orchestre et condamné à flotter d’un pupitre à un autre, qui le soumettant à l’introspection un peu solennelle d’un cor, qui lui réservant perfidement l’accueil cauteleux du piano, qui le jetant sans ménagement dans la cohue de bois moins avenants que reptiliens. Inutile de le garder secret, la frustration s’en trouve décuplée de voir ce pandémonium mortellement séduisant pâtir d’un son qu’on ne décrira pas, tant s’en faut, comme cristallin. En l’absence des bandes d’origine déplorée par Kritzerland, celui-ci s’est résolu à fournir un album de bric et de broc, dont la carte maitresse, appel à l’indulgence, tient moins à un nettoyage audio somme toute anodin qu’à la nature « taiseuse » du film. Qui sait ? Certains esprits sarcastiques loueront peut-être ces scories polluant les sillons du disque, ces rires passagers et autres émissions parasites ainsi qu’un involontaire prolongement de l’expérience sensorielle marquante que propose Dementia.
Justement, en parlant sarcasme… Le brocard n’est pas loin quand une douce ritournelle de boîte à musique se gausse, l’air de rien, du symbolisme éléphantesque dont le récit suinte : transformé par une aberration de perspective en monstruosité tumescente, le cigare que fume un quelconque richard darde son extremité rougeoyante sur les jambes nonchalamment croisées de la Gamine. Dans la foulée, George Antheil, déjà lassé de cette brève giclée d’ironie, succombe à l’instar de l’héroïne meurtrière à une frénésie hors de contrôle. Peu après que le rupin suscité ait vu ses très subtiles avances récompensées d’un coup de couteau en plein ventre, la femme s’acharne sur ses doigts crispés autour de ce qui pourrait bien devenir une compromettante pièce à conviction. S’armant de sa lame, elle réduit la main en charpie tandis qu’une contrebasse au supplice s’abîme dans des glissandi nauséeux, implacables témoins de la folie qui, désormais, bourdonne sans entrave entre ses tempes.
A compter de cet instant charnière, la musique se défausse du simulacre de retenue qu’elle donnait ici ou là le sentiment d’arborer. Avec un singulier mélange de jouissance et de panique irraisonnée, sa violence larvée éclate. Les pérégrinations nocturnes qui sont le cœur de Dementia, placées depuis le départ sous le signe de la fuite en avant, franchissent ainsi un nouveau palier au bout duquel ne se tapit plus qu’une démence avide. La Gamine y tombe tête la première alors qu’elle pensait avoir trouvé refuge dans un cabaret bondé. La parfaite occurrence pour une bonne louche de source music, apparemment de la main d’Antheil lui-même. Mais les frontières entre accompagnement intradiégétique et partition de cinéma s’avèrent aussi poreuses que celles séparant d’une strie floue le monde réel des ténébreuses psychoses de l’héroïne. N’y a-t-il pas tout à coup une once de moquerie cachée dans ce solo de trompette ? Une humeur sardonique ne guiderait-elle pas soudain les mains du pianiste sur son clavier ? Il n’a pas échappé aux fourbes jazzmen, non plus d’ailleurs qu’aux clients gagnés peu à peu par l’hilarité, qu’un piège était sur le point d’engloutir la fugitive ne se doutant de rien, elle. Et le thème principal, l’antienne funèbre maculant le papier à musique de mille commotions mentales, surgit alors derechef de sa cachette pour donner à sa proie un ultime baiser glacé.
La ficelle n’était peut-être pas aussi grosse dans les lointaines fifties qu’elle ne le paraît aujourd’hui, mais d’aucuns, à l’époque, durent esquisser un sourire entendu en voyant la Gamine se réveiller en sursaut dans sa minable chambre d’hôtel. Les mains tendues, semblant préfigurer les monstres de Night Of The Living Dead (La Nuit des Morts-Vivants), qui l’encerclaient telle une forêt blême, la voix plus éthérée que jamais de Marni Nixon, lugubre à l’égal des sanglots des damnés, n’étaient donc qu’un mauvais songe ? John Parker se garde bien comme on pouvait s’y attendre de se montrer catégorique, et le mot « Fin » fait surtout figure de cache-misère pour un point d’interrogation défaillant d’un terrible cri d’effroi. Quant à l’auditeur laissé groggy par tant de macabre maestria, il n’est pas arrivé lui non plus au bout de ses peines — ou plutôt, en ce qui le concerne, des réjouissances. Les notes terminales de Dementia à peine dissoutes dans un ciel givré d’étoiles, voici que déboule sans crier gare… le Piano Concerto d’Ernest Gold, écrit durant ses vertes années. Quid ? Quomodo ? Les collaborations cordiales, et semble-t-il mêlées d’une réelle estime, qu’Antheil et Gold entretinrent à maintes reprises, comme ici sur le film de John Parker où le second cité tint la baguette, pourraient expliquer ce bonus inopiné. Et quitte à pousser les élucubrations vers les rives du saugrenu, l’on mentionnera que notre invité surprise fut pendant presque vingt ans l’époux de… Marni Nixon.
Et la musique, dans cet imbroglio, qu’a-t-elle à dire ? Curieusement, l’oreille s’emploie d’emblée à débusquer le plus insignifiant dénominateur commun entre l’écriture pleine d’énergie de Gold et le sinistre récital qui a précédé, comme si leur cohabitation sur un même disque attestait d’indiscutable façon leur gémellité profonde. Et pour tout avouer, il y a parfois dans les embardées de ce vigoureux concerto quelque chose ayant l’allure d’une réminiscence trouble, mais transformée par le passage de l’ombre à la lumière. Tout à coup, le piano ne psalmodie plus les malédictions de l’au-delà, mais s’adonne à un romantisme ébouriffé, où, derrière la fougue emportant tout sur son passage, s’ébauche une forme de grandiose sérénité. Rien n’empêche, bien sûr, de trouver tout cela tiré par les cheveux. On se satisfera plus humblement alors de goûter au charme d’une exubérante œuvre de jeunesse, dans laquelle son géniteur, qui n’imaginait guère faire carrière au sein du cinéma, se fiche autant que d’une guigne de marcher dans les clous d’une illusoire « honorabilité classique ». En cela, malgré des trajectoires artistiques qui régulièrement furent aux antipodes l’une de l’autre, George Antheil et Ernest Gold s’affirment ici en véritables frères de la triple croche. Des braves, sourds au qu’en-dira-t-on du Landerneau mélomane qui n’aurait pas détesté les voir tous deux étouffer leurs peu défendables instincts.













