 LE LAC DES MORTS-VIVANTS (1981)
LE LAC DES MORTS-VIVANTS (1981)
Compositeur : Daniel J. White
Durée : 43:19 | 23 pistes
Éditeur : Omega Productions
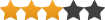
L’étang dont le soleil chauffe la somnolence
Est fleuri, ce matin, de beaux nénuphars blancs ;
Les uns, sortis de l’eau, se dressent tout tremblants,
Et dans l’air parfumé leur tige se balance.
D’autres n’ont encor pu fièrement émerger :
Mais leur fleur vient sourire à la surface lisse.
On les voit remuer doucement et nager :
L’eau frissonnante affleure aux bords de leur calice.
Edmond Rostand, noble auteur des Nénuphars, imaginait-il rien qu’un instant que les paresseuses ondulations des nymphéacées pouvaient être dues à un bataillon de zombies verdâtres, tirés par quelque malédiction de leur long sommeil aquatique ? Sous la caméra à moitié escoffiée d’un Jean Rollin incrédule, le poème animiste n’est plus que vers de mirliton. Mais au lieu de stigmatiser trop durement le cinéaste, parachuté bon gré mal gré sur Le Lac des Morts-Vivants la veille du tournage, la justice réclamerait plutôt que l’on fasse un sort à Marius Lesoeur, grand manitou de la mythique société de production Eurociné. Un cas à part, cette boîte, dans une France peu sensible au fumet capiteux du cinoche d’exploitation, et dont le culte qui l’auréole toujours, imbitable auprès du commun des mortels, doit tout aux aberrations d’un système D que Lesoeur substituait comme à son habitude à tout budget digne de ce nom. Sa pingrerie, dit-on, échauda même Jess Franco, un familier pourtant des projets spartiates, qui devait selon certaines rumeurs filmer en personne cet émule champêtre de la sensation des eighties naissantes, évidemment le Dawn Of The Dead du regretté George Romero.
L’hypothèse, jamais vraiment avérée, garde néanmoins tout son charme de par la seule présence de quelques-uns des hommes-liges du réalisateur espagnol : Howard Vernon, qui s’accroche à sa dignité branlante au milieu d’un parterre de figurants abyssaux, et le compositeur Daniel J. White, écossais d’origine (le port du kilt lui était une délectable excentricité) mais Parisien jusqu’au bout des ongles. C’est à ce dernier qu’il incombe de faire souffler un vent de terreur sur la campagne picarde où déambulent nos revenants dégingandés, bien plus, à dire la vérité, qu’au pauvre Rollin, hagard et déboussolé loin des bancs de brume que ses films évanescents ont toujours peuplés de succubes glorieusement nus. La naïade hâlée qui, dès la première bobine, (se) coule dans les eaux traîtresses eût pu l’émouvoir, mais non. White, par contre, les yeux rivés sur le delta noir qu’exhibe ingénument la batifoleuse, fredonne aussitôt un petit air d’easy listening, mâtiné des couinements d’un ersatz d’orgue, qu’en dépit de son titre un rien prétentieux (Atlantide Story) on s’amuse à imaginer provenant tout droit des swinging sixties.
Et rien ne prouve que ce ne soit pas le cas, d’ailleurs : cette petite sucrerie arrive en fait de la bibliothèque personnelle de White, des étagères bondées à craquer d’échantillons musicaux au hasard desquelles il piocha, tout du long d’une carrière forte de plusieurs décennies, pour alimenter sans distinction des émissions de radio, des kilomètres de publicité, de petits films télévisuels et, bien sûr, le grand écran. Il en va de même pour cette autre baignade friponne qui déshabille non plus une seule gourgandine, mais toute une congrégation. A l’écoute des vocalises tropéziennes débordant du judicieusement nommé Nudist Sequence, voici le spectateur comme le mélomane projetés à des lieues du film d’horreur rural, en direction des plages de sable fin où Max Pecas, l’empereur de la gaudriole estivale, s’apprêtait à l’époque à planter son quartier général. En fouillant lui-même ses propres archives afin de musicaliser telle ou telle commande, Daniel White ne fit pas toujours preuve d’un discernement infaillible, tant s’en faut. Mais là où ses emprunts destinés aux clapotis vaguement érotiques du Lac des Morts-Vivants ne ressemblent qu’à d’aimables canulars, le chapardage du fameux thème de La Comtesse Noire, classique révéré dans l’œuvre fourre-tout de Jess Franco, arbore tout au contraire de bien cyniques allures.
C’est là un film envers lequel le trublion ibérique n’a jamais caché sa préférence ni sa fierté, une fantasmagorie ceinte d’un lourd brouillard qui aiguilla le compositeur vers l’un de ses doux achèvements élégiaques. Quelle n’est pas la stupeur du fantasticophile aguerri, en train de se tenir les côtes face à un Z franchouillard désespérément mal fichu, de tomber soudain nez à nez avec ces très familières cordes veloutées ! Il faut croire que White, pressé par le temps comme à peu près tout le monde sur le plateau, n’avait pu qu’effectuer sa sélection en catastrophe. Ou bien était-ce que, songeant avec amertume à l’implication avortée de son ami Jess Franco, il avait tenté de sauver par ses humbles moyens les retrouvailles entre un spectre et la fille qu’il n’a jamais vu grandir — réminiscence, tout à fait volontaire peut-être, d’une petite réussite mal-aimée de Franco, El Secreto del Doctor Orloff (Les Maîtresses du Dr. Jekyll). Fréquemment appelé en renfort, le Love Theme, chagrin et passionné, qu’un écho d’outre-tombe réfrigère parfois, renvoie tout autant à l’amour paternel brimé par la mort qu’aux transports charnels (baptisés Eromantic Violins par le tracklisting, nullement du genre à s’effaroucher d’un téton volage) que le zombie, de son vivant, connut dans les bras de son dernier amour.
A l’écran, Eurociné oblige, ça n’est plus la même limonade. Si voluptueux soit-il, le phrasé de Daniel White n’est définitivement pas de taille à lutter contre la trogne hallucinée, yeux ronds comme des billes s’ouvrant au milieu d’un maquillage craquelé, que le cadavre ambulant présente pour expression unique à la vue de sa progéniture. Ses camarades ressuscités, soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale qui périrent dans un traquenard tendu par des villageois français, ne sont pas vraiment mieux lotis. Quand les prend la lassitude de reluquer les sirènes effeuillées depuis les profondeurs du lac maudit (dont même la magie du cinéma est impuissante à masquer la vraie nature : celle d’une piscine aux parois aisément discernables), ils surgissent à l’air libre, leur fard coulant en traînées visqueuses et les anxiogènes Peasent Terror et Aquatic Sequence ne reculant devant aucun gargouillis mortuaire pour hérisser jusqu’aux plus minuscules poils de la nuque. Il s’agirait bien, une fois n’est pas coutume, d’une création originale de la part de Daniel White. Ce qui n’empêche pas notre pragmatique compositeur de battre le rappel de ses vieilles formules grinçantes, dont le cinéma fantastique des années 60 et 70 lui permit de faire un emploi prolifique. Snobant toute construction un tant soit peu harmonieuse, il jette guimbarde sinistre, clavecin peu amène, orgue de mauvaise vie et un chapelet de percussions aussi mordantes qu’une arête de glace au fond d’une fosse emplie d’inquiétantes réverbérations.
Le fin gourmet accoutumé à trouver sa pitance dans les extrémismes de l’avant-garde plutôt qu’entre les moelleux accoudoirs de la mélodie ciselée ne devrait pas bouder le plaisir d’une écoute isolée. Du côté du simple spectateur, les choses se gâtent, hélas. A la vision d’une ixième vadrouille fantôme en pleine cambrousse, la savante cacophonie, usée déjà par ses invocations jusqu’à satiété, ne peut endiguer les vertus cocasses de l’impayable rigor mortis des trépassés vengeurs. Les gens du cru, baignant pour leur part dans l’inconscience candide du ridicule qui montre les crocs, s’époumonent à tout prétexte d’une terreur somptueusement mimée. Le disque, à l’instar de dizaines d’autres albums qui, faute d’un matériau approprié, prélèvent leur substance à même la piste sonore du film, est rempli de ces délectables échos. Les néophytes tomberont des nues, les bisseux inconsolables d’une certaine idée de la ringardise bleu, blanc, rouge, râleront d’extase en reconnaissant les trilles récurrents d’un volatile non identifié (ténébreux engoulevent ou rouge-gorge enrhumé ? Un jour, l’Histoire tranchera), la harangue d’un Howard Vernon aussi solennel qu’un seigneur de guerre galvanisant ses troupes cuirassées et, bien sûr, le légendaire vocable glapi par un benêt très motivé, dont les cruciverbistes s’essaient encore, trente-six ans après les faits, à décrypter le message caché.
Pour sa deuxième galette seulement, le label Omega n’a pas choisi l’une de ces gourmandises éditoriales aptes à faire gicler de leurs orbites les yeux du béophile lambda. Dans l’ombre des géants Intrada, Varese ou La-La Land, le petit Poucet toujours imberbe est peut-être condamné à brève échéance à l’extinction. Et personne ne versera de larmes sur sa dépouille… Mais qui sait ? La fièvre du Z fait main, dans lequel le prochain La Revanche des Mortes-Vivantes entérine d’ores et déjà la spécialisation d’Omega, consumera peut-être bientôt le petit monde des adorateurs de la musique de film. Et les anciens stakhanovistes d’en bas comme Daniel J. White deviendront alors, même par-delà le sépulcre, les maîtres de ce nouvel ordre déliquescent. Oui, pourquoi pas ? Bon sang, on y croit ! Dur comme fer ! Promizoulin !













