 FASCINATION / REQUIEM POUR UN VAMPIRE (1979 / 1971)
FASCINATION / REQUIEM POUR UN VAMPIRE (1979 / 1971)
Compositeurs : Philippe d’Aram / Pierre Raph
Durée : 43:53 | 29 pistes
Éditeur : Finders Keepers
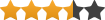
Choisis ton camp, camarade ! Avec Jean Rollin au centre des débats cinéphiles, le recours pourtant si pratique à la demi-mesure et au consensus tiède devient chose quasiment impossible. Certains mettent toute leur ardeur à défendre l’incorruptible poète, l’artiste en dehors des modes et du temps même, dont la souveraine fascination pour les landes moutonnées de brume, les diaphanes créatures de la nuit et le sang souillant une peau d’albâtre était la clé ouvrant les portes d’un univers sans aucun pareil dans le cinéma français. Les autres, une moue dédaigneuse aux lèvres, n’ont pas assez de mots pour crucifier un petit troufion du Z, qui s’y entendait au moins autant que Jess Franco à ses heures les plus neurasthéniques pour étaler de la fesse molle à l’écran. Une chose est néanmoins certaine, Rollin était le plus fidèle des amants. Rarement a-t-il dérogé aux songes délétères qu’il cultivait amoureusement, tel un petit carré d’herbe pétrifiée où flottaient d’étranges murmures. Et la musique elle-même comptait au nombre de ces obsessions, ressassées film après film. Philippe d’Aram, Pierre Raph, François Tusques, Acanthus, tous ont suivi Rollin, dociles, à travers les campagnes blafardes et les cimetières profanés.
En d’autres lieux moins propices aux effusions d’une si macabre sensibilité, le réalisateur aurait dû s’acclimater, on l’imagine, aux coups de boutoir sonores d’un Chuck Cirino. L’hypothèse fait frémir. Dépouillé d’une de ses plus fantasmagoriques parures, l’œuvre de Rollin aurait assurément vu fléchir son pouvoir d’attraction. Que serait devenu Fascination sans les synthés caverneux que Philippe d’Aram éparpille judicieusement ? En permanence sur le fil du rasoir, comme toujours chez le cinéaste, les déambulations champêtres d’actrices seulement vêtues de déshabillés vaporeux (quand elles portaient quelque chose, s’entend) trouvent dans la partition des résonances poétiques salutaires. Le palais du fin épicurien croirait même détecter un arrière-goût des ondes Martenot, dont les langueurs fameuses, souvent associées à un contexte surnaturel, semblent s’esquisser ça et là dans les gémissements arrachés par le compositeur à ses instruments. Ingénieuse manière pour ce dernier de prouver que les images liminaires, où deux jeunes femmes dansent au son de la valse fantomatique d’un gramophone, vont introduire à tout autre chose qu’une chronique ordinaire de la haute bourgeoisie.
Béni soit Finders Keepers ! Malgré l’estime éternelle que leur vouent les amateurs de musique de film, on imaginait mal Intrada ou La-La Land partir à l’abordage du monde froid et décadent de notre Jean national. Pareil challenge ne pouvait qu’au contraire exciter l’inaltérable goût de l’éditeur londonien pour les bizarreries musicales non identifiées, dont son catalogue déborde de toutes parts. Ses ressources logistiques étant hélas sans commune mesure avec celles des deux béhémoths précités, les albums frappés de son sceau s’avèrent souvent faits de bric et de broc, et seule une mansuétude complice permettra d’absoudre les résidus bruités et dialogués, tout droit issus des films eux-mêmes, qui hachent inopinément l’écoute. Quoique, il n’est pas défendu de trouver dans ces scories une sorte de charme pervers, inhérent à l’expérience musicale. L’émotion qui enroue la voix de Brigitte Lahaie (dont l’apparition en ange de la mort à moitié nu, fendant l’air d’une gigantesque faux, éblouit autant le regard que celle d’Ursula Andress jaillie des flots dans Dr. No), alors qu’elle donne libre cours à son désarroi dans Death Brigitte, s’insinue ainsi sans qu’on n’y prête attention parmi les délicats accords du piano de L’Amour des Deux Filles, qui lui emboîte le pas. Et s’ils paraissent toujours autant provenir de l’au-delà, les «synthés Martenot» se colorent cette fois d’une mélancolie rien moins qu’inattendue.
En manière de préambule, Requiem pour un Vampire donne lui aussi de la voix. Sauf que l’on n’entend plus un sensuel murmure féminin glorifier le culte du sang, mais les râles moribonds d’un homme de toute évidence en fâcheuse posture. Aussi peu ragoûtants soient-ils, ces gargouillis laissent finalement entrevoir un peu de la teneur viscérale d’un score très différent de Fascination, en tout cas plus ostensiblement ancré dans son époque. En 1971, le psychédélisme rock qui avait mis sens dessus dessous les sixties n’avait pas encore dit son dernier mot, et c’est tous riffs graisseux dehors qu’il s’invite dans Batterie Fields et Crotch Batterie, les bien nommés. N’y voyez pas pour autant le caprice d’un Pierre Raph ne se souciant que de ratisser large. Ici, les héroïnes de Jean Rollin ne sont pas de lascives succubes mais des fugueuses en furie, bardées de flingues et peinturlurées du masque criard des clowns. L’imagerie rêvée pour convoquer, dans un grand élan visionnaire, les prémices des rugissements punks ? Même pas, le compositeur, en osmose avec la proverbiale passion du cinéaste pour «l’inquiétante étrangeté», préférant mettre l’accent sur les parfums bucoliques d’une cavale au milieu de nulle part. Des inflexions tziganes, légères et curieuses, paraissent se dégager des vifs pincements de guitare de Jade Lake, avant qu’un bis repetita dans Jaded Cottage, où les bois émettent soudain leur plainte, ne fasse saillir à la surface de ce ton doucereux de sombres nervures.
S’il existe un passage quasi obligé dans l’œuvre de Rollin, sans lequel ses films ne seraient pas tout à fait ce qu’ils sont, c’est bien la découverte du mystérieux château et de l’horreur qu’il abrite. Fascination se plie au rituel avec la lourde et gutturale mélopée de ses synthés, qui n’aurait pas dépareillé, tout bien réfléchi, chez Todd Browning ou James Whale. Requiem pour un Vampire, de son côté, réplique avec ce qui s’impose sans mal comme le plus audacieux moment de la partition. Riche d’un hétéroclite corpus d’instruments, qui se frôlent, se chevauchent et se repoussent comme on jouerait des coudes dans une foule grouillante, Murs du Château se plait à multiplier les brusques cassures de rythme, comme s’il s’escrimait à épouser les arêtes des ruines ancestrales se dressant sous le regard des fuyardes. Bien des sacrifices monstrueux ont dû ensanglanter ces décombres, nous chuchote notre imagination perfide, et de fait, le stressé Diabolical, avec son solo de piano régulièrement traversé des échos d’un gong solennel, a les atours même modestes d’une messe païenne. C’est sur son autel que meurent l’innocence et la candeur virginale qui auréolaient bizarrement les deux femmes, pétroleuses prêtes à faire parler la poudre, certes, mais surtout petites filles désemparées face aux tableaux déliquescents de Jean Rollin.
Obnubilé par la destruction de la pureté, le réalisateur de Lèvres de Sang et des Raisins de la Mort était peut-être moins homme de cinéma dans l’âme que conteur à la plume stylisée. Peu importe, en réalité, que ses œuvres aient été grevées de maladresses prêtant le flanc aux lazzis. Rien ne comptait davantage à ses yeux que perdre le spectateur dans les méandres de la fable noire, là où ce qui est communément tenu pour la norme n’a plus aucun droit de cité. Un ténébreux paradis, tout entier contenu à l’intérieur du lourd grimoire du prologue de Fascination, et dont les pages, religieusement choyées par un bras gracile, se tournent en harmonie avec l’envoûtant simulacre choral de Philippe d’Aram.













