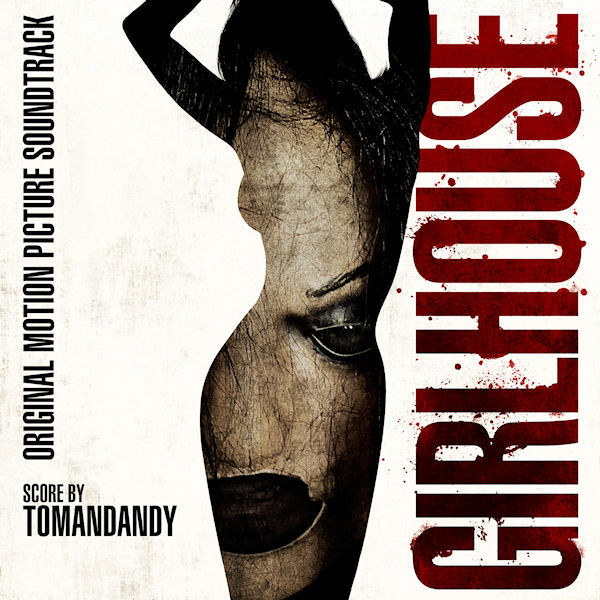RESIDENT EVIL: AFTERLIFE (2010)
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE (2010)
RESIDENT EVIL : AFTERLIFE
Compositeurs : tomandandy
Durée : 43:21 | 20 pistes
Éditeur : Milan Music
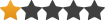
Pour le volet final (?) de la saga, c’est Paul Anderson qui revient à la réalisation, comme pour boucler la boucle. Hélas, il ne fait pas appel cette fois-ci à Marco Beltrami, qui aurait pu permettre de conclure en beauté l’aventure musicale de Resident Evil. C’est alors que le tandem tomandandy entre en scène, spécialisé dans le genre fantastique et horrifique depuis The Mothman Prophecies (La Prophétie des Ombres) en 2002, avec des titres comme The Hills Have Eyes (La Colline a des Yeux), P2 (Deuxième Sous-sol) et The Covenant (Le Pacte du Sang). Pour Resident Evil : Afterlife, le réalisateur demande aux deux compositeurs, selon leurs propres dires, d’éviter les clichés, et les pousse à explorer à fond les limites de leurs expérimentations habituelles visant à abolir les frontières entre effets sonores et sound design. Vous ne voyez pas la différence ? Rassurez-vous, eux non plus. Quand on entend cela, on est tenté de rire car le résultat de leur travail est précisément une somme de clichés : en effet, ils ne réinventent absolument rien et s’inscrivent dans une mode éculée depuis déjà plusieurs années, livrant une composition beaucoup plus proche du bruit que de la musique.
Depuis toujours, tomandandy ont préféré l’usage des synthétiseurs à celui des instruments acoustiques. Pourquoi pas ? Cela a occasionné parfois quelques réussites et a plutôt bien fonctionné dans les films dramatiques à la tonalité rêveuse et nettement dépressive (Mean Creek en est le meilleur exemple). En outre, pour le premier et le troisième opus de la saga Resident Evil, c’est aussi l’option électronique, soi-disant plus adaptée à l’adaptation d’un jeu vidéo et à un univers futuriste, qui a été retenue. Simplement, il faut y ajouter quelques idées thématiques et / ou instrumentales valables, sinon cela ne tient pas debout, ce n’est que du remplissage paresseux et fort peu agréable à écouter. A l’écran, cela fonctionne à peu près, noyé dans la masse, mais sur l’album c’est autre chose. Tokyo, avec ce qui ressemble à une guitare électrique déchirante et des chœurs samplés aux accents gutturaux, tout cela noyé dans un fatras vaguement branché, fait plutôt bien illusion, mais les choses vont se gâter très rapidement. Dès Umbrella, on sombre dans le tout-venant de la musique technoïde à la Paul Haslinger, prisée actuellement dans bon nombre de films horrifiques : instrumentations metal sans vrais instruments (la batterie et la guitare électrique sonnent très synthétiques) et abondance de sonorités discordantes fracassant les oreilles sur un mode à la fois lancinant et hystérique (voir les horribles Twins et Party, véritables archétypes de la musique dégénérée).
Pas de thème, pas de structure mais une progression erratique, des boucles rythmiques obsédantes, des cognements et des couinements métalliques, des halètements survoltés, des vrombissements de machines infernales… À certains moments l’on se croirait dans l’atroce Gamer (Ultimate Game) de Robert Williamson et Geoff Zanelli, c’est dire si l’on tombe bas ! Comme toujours, il faut donc se rabattre sur les pistes contemplatives et planantes, souvent envoûtantes, parfois émouvantes : Far, le début de Flying puis Memory constituent par exemple une pause plutôt bienvenue en milieu d’album, par ailleurs empli de morceaux complètement vides (Prison, Discovery) ou assourdissants (Axe Man). On comptera encore parmi les titres écoutables le très désespéré et apocalyptique Arcadia puis le lyrique Promise, qui auraient bien trouvé leur place dans les plaines arides et désolées du troisième opus signé Charlie Clouser. Pour le reste, mieux vaut oublier ce piteux travail livré par des musiciens sans grande inspiration, incontestablement le plus faible de la saga.