 LE MAGASIN DES SUICIDES (2012)
LE MAGASIN DES SUICIDES (2012)
Compositeur : Etienne Perruchon
Durée : 66:27 | 38 pistes
Éditeur : Idol
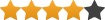
On aurait aimé entendre un critique hardi invoquer, même en coup de vent, les farandoles ténébreuses de Jan Svankmajer, Jiri Barta, Rintaro ou les frères Quay, grands chambellans de l’animation faite cauchemar. On aurait apprécié qu’une poignée de spectateurs aient eu le sentiment d’un film de Jacques Demy dépouillé de ses tons pastel, ou d’une farce grinçante dans laquelle Fred Astaire broierait du noir. Au lieu de quoi, tout le monde n’a discerné dans Le Magasin des Suicides que l’inévitable legs de Tim Burton. Preuve éloquente, s’il en était encore besoin, que le turbulent diablotin de Burbank a si étroitement fait sien le macabre et la féérie qu’aucun cinéaste, fût-il gorgé de talent, ne peut espérer se frotter au genre sans être aussitôt accusé de violation de domicile. Mais n’allons pas non plus donner de trop vastes ambitions à Patrice Leconte, lui qui confesse avoir volontiers emboîté le pas au réalisateur de Sweeney Todd pour parer des couleurs adéquates sa sympathique adaptation du roman de Jean Teulé. Tout au plus un maigre emprunt au dessinateur Charles Addams, dont les yeux pochés et le port aristocratique du Gomez de The Addams Family (La Famille Addams) ont servi de modèle manifeste au personnage de Mishima, parviendra in fine à chahuter une inspiration sans cela unilatérale, laquelle pourrait fort bien avoir phagocyté la musique à son tour. Car qui dit Tim Burton dit immanquablement Danny Elfman, dont les violents traits de cordes, l’orgue au souffle méphistophélique et les tintements de clochettes célestes restent aujourd’hui encore gravés dans le marbre des tables de la Loi.
Le fait est que tous les instruments susmentionnés figurent dans les travées du Magasin des Suicides, observation amplement suffisante aux auditeurs un peu dilettantes pour balancer Etienne Perruchon parmi les plagiaires de peu d’éthique. Mais ce dernier, auteur des très belles partitions chorales de Dogora et Tchikidan, possède son propre vocable, dans lequel les masses de béton aux teintes cendreuses et les silhouettes pathétiques qui peuplent le film vont s’imbriquer à merveille. Appelé à la rescousse très en amont du projet, qui lui promettait de surcroît les luxes symphoniques du Brussels Philharmonic, le compositeur a eu toute latitude pour créer, en étroite collaboration avec Leconte s’improvisant parolier, une ample comédie musicale… Mais pas n’importe laquelle. A cent lieues de la bonne humeur souvent caractéristique du genre, qu’augurait pourtant un incipit réchauffé par le vigoureux Y’a d’la Joie de Charles Trenet, ce musical-là puise son allant dans une flaque stagnante de sinistrose. Le Piéton Rescapé, véritable chant de désespoir, émeut étrangement par ses harmonies d’un noir d’ébène et la voix sans force d’un pauvre hère au bout du rouleau. Des comme lui, la ville en compte des milliers d’autres, tous n’attendant que l’instant propice pour mettre fin à leurs tourments.
N’a-t-on pas coutume de prétendre que le malheur des uns fait le bonheur des autres ? L’adage n’a jamais été aussi vrai qu’en ce qui concerne les tenanciers prospères du Magasin des Suicides, qui se font un plaisir, dans l’étourdissante Chanson des Tuvache, d’exposer à leur clientèle morose les mille et une façons de quitter ce bas-monde. Outre la révélation d’un thème mémorable, à mi-chemin entre la marche funèbre et la valse déglinguée, qui tiendra lieu de matière première à Perruchon pour façonner son ouvrage, cette chanson permet aussi de lier connaissance avec la sinistre famille Tuvache et ses interprètes vocaux. Mishima, le patriarche, jouit du timbre suave de l’excellent Bernard Alane, tandis que sa dévouée moitié Lucrèce s’incarne à travers les vocalises capiteuses d’Isabelle Spade. Ensemble, ils s’abîmeront plus tard dans Le Duo de Lucrèce et Mishima, mise à nu tristement élégiaque de leur vague à l’âme, pas moins dévorant, en fin de compte, que celui de leurs concitoyens qu’ils aiguillent chaque jour vers l’au-delà. Et si Patrice Leconte s’essaie avec une réussite inégale à émuler la verve acide des dialogues écrits par Jean Teulé, Perruchon, pour sa part, se régale à composer une autre petite merveille de mélodie sombre. Dépressive, faudrait-il même dire, la faute en incombant au lamento discret de l’orgue et aux soudaines poussées tragiques de l’orchestre, qui charbonnent à satiété une atmosphère déjà couleur de plomb.
Aussi incroyable que cela paraisse, isolé et fragile dans la désolation urbaine mais d’une générosité sans borne, un rai de soleil existe. Alan, le petit dernier des Tuvache, qui promène partout son sourire espiègle, détonne au milieu de la cohorte des faciès d’enterrement. Depuis la reprise carnavalesque du thème principal dans La Naissance d’Alan jusqu’à l’emballement des cordes d’Un Enfant Joyeux, la musique ménage, comme autant d’oasis prises en étau entre de vastes étendues blêmes, une suite enlevée de minuscules et rieurs « happy fews ». Tout cela au grand dam, évidemment, des géniteurs du souriant galopin, à telle enseigne que Mishima se voit presque étriper la honte de la famille sur fond de cordes dentelées, ouvertement héritées du Psycho (Psychose) de Bernard Herrmann. Mais il ne tarde pas à retrouver contenance, et avec elle un rictus matois, lorsque lui vient l’idée dans Alan Fume d’accoutumer son fils à la cigarette. Peut-être qu’ainsi, raisonne-t-il au son patelin des trombones et du clavecin, un cancer des poumons réussira à entamer ce satané sourire !
Mais Alan n’a pas du tout l’intention de succomber à la grisaille ambiante. « A mort la mort ! » s’exclame son interprète Kacey Mottet Klein dans la chanson éponyme, où les premiers accords dramatiques s’estompent bientôt pour dévoiler un petit thème résolu, à la rythmique un brin martiale. Le garçon et sa bande ont un plan d’action, qu’ils se dépêchent d’aller mettre en œuvre dans Les Enfants Conspirateurs. Derrière les chœurs juvéniles, on a tôt fait de reconnaître une excroissance du thème des Tuvache, fonçant à contre-courant de l’entrain morbide dont on le pensait indissociable pour exhorter violemment la populace à sortir de sa dangereuse somnolence. En guise d’outil de persuasion, Shake Your Body, morceau de source music qu’un mixage volontairement outrancier transforme à l’écran en mélasse sonore, assaille la façade du Magasin des Suicides de ses humeurs pseudo-funky. Miracle ! Des sourires se dessinent ça et là, des pieds comment à battre timidement la mesure. Mais si la musique prouve une nouvelle fois qu’elle a bien le pouvoir d’adoucir les mœurs, elle ne parvient qu’à pousser à bout l’infortuné Mishima. Abattu par la dépression, qui prenait dans Chez le Psy l’apparence d’un terrible nuage bourré de cuivres assourdissants en guise d’éclairs, il craque et se lance aux trousses d’Alan en fendant l’air d’un katana ! Cette course-poursuite scindée en deux volets distincts, Fillicide Run et Vox Face à Face, donne à admirer l’aisance dont fait montre Perruchon en jonglant avec son abondant matériau thématique, n’ayant besoin que de l’essor subit des cordes pour figurer la rage vindicative du père ou de quelques touchants accords de piano pour illustrer le drôle de petit courage du fils.
En ce qui le concerne, Patrice Leconte a eu la main plus lourde. La conclusion doucement ouverte du roman l’ayant laissé sur sa faim, il s’est senti dans l’obligation d’étouffer tous ces noirs bilieux et ces gris anthracite sous un épais tapis bariolé. Visiblement pas transporté par cette éruption de chantilly comme il avait su l’être par les ambiances cafardeuses, Perruchon s’acquitte de son devoir en chancelant parfois dangereusement aux frontières du mauvais goût (les minauderies sirupeuses à souhait du Joli Garçon et Marylin), même si les heureux aléas de son inspiration l’amènent également à botter en touche avec malice (La Crêperie « Au Bon Vivant » et ses légers accents celtes, aussi inattendus que bien tournés). Le meilleur, dans cette déferlante de sentimentalisme pour le moins gluant, reste sans conteste l’apothéose finale de La Vie Vaut Mieux que la Mort, où les chants de félicité des vivants, tout en cuivres solennels, s’entremêlent aux lamentations des morts déjà nostalgiques de leur existence terrestre. Mais le compositeur, d’évidence, a grand-hâte de renouer une ultime fois avec les lugubres épanchements du Magasin des Suicides, forcément plus séduisants. Carte blanche lui est alors attribuée grâce au splendide générique de fin, longue suite dans laquelle il jette en vrac quelques-uns de ses multiples thèmes, à commencer (à tout seigneur tout honneur) par celui des Tuvache, qui n’a jamais été aussi spectaculaire qu’ici. Leconte possède peut-être les clefs de la ténébreuse boutique, mais Etienne Perruchon a assurément pris soin d’en conserver un double. Et même les clients les plus réticents ne tergiverseraient guère, sous le charme de son volubile abattage symphonique, avant de franchir le seuil.













