 KOZURE OKAMI – THE BEST OF LONE WOLF AND CUB (1972 / 1973 / 1974)
KOZURE OKAMI – THE BEST OF LONE WOLF AND CUB (1972 / 1973 / 1974)
BABY CART
Compositeurs : Hideakira Sakurai & Kunihiko Murai
Durée : 49:46 | 25 pistes
Éditeur : La-La Land Records
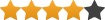
Tout a commencé avec Yojimbo, d’une certaine manière. En dépossédant de ses vertueuses aspirations la figure légendaire du samouraï pour en faire un va-nu-pieds au profil rabelaisien, Akira Kurosawa ne se doutait pas de l’influence colossale que son film propagerait tous azimuts. Erigé en modèle non avoué de son «petit» western Per un Pugno di Dollari (Pour une Poignée de Dollars), il a indirectement œuvré à la création des archétypes de l’Ouest italien, entre mercenaires à la mine patibulaire, décors arides battus par les vents et cynisme désabusé. Le chambara lui-même (ou film de sabre nippon) n’est pas sorti indemne de cette désagrégation mythologique et, à l’instar de son lointain parent transalpin, a vu proliférer les héros revenus de tout. L’impavide Itto Ogami est l’un d’entre eux, et davantage encore : un véritable monument de nihilisme à lui seul, qui a catapulté la saga Kozure Okami (Baby Cart) vers des sommets baroques. Quatre décennies plus tard, ce morceau fabuleusement gratiné de contre-culture demeure emblématique des turbulentes seventies, où le cinéma d’exploitation japonais et une Cinecittà décadente avaient noué pléthore de liens par-delà les continents. Même violence exubérante, mêmes délires graphiques, même iconoclasme parfois goguenard… et mêmes audaces musicales, foulant aux pieds le classicisme symphonique pour accoucher de partitions hybrides, férocement modernes. Tandis que la révolution latine instiguée par Ennio Morricone et ses talentueux condisciples battait son plein, les compositeurs de l’Archipel se dédouanaient de l’héritage des Maîtres tels que Toru Takemitsu et Akira Ifukube, et succombaient avec jubilation aux joies du métissage bigarré. Et c’est peu de dire que Hideakira Sakurai, le maître d’œuvre de Baby Cart, a enjambé tous les garde-fous.
Difficile pour le compositeur de ne pas céder à l’élan procuré par Kenji Misumi qui, toutes les trois bobines, au long des quatre films qu’il réalise entre 1972 et 73, assène dans le dos du musicien, et sur les rétines ahuries des spectateurs, d’irrésistibles bourrades aux limites du cinéma expérimental. Impossible de ne pas passer par dessus la balustrade. Qu’on ne s’y trompe pas : s’il s’agit bien ici de cinéma d’exploitation (littéralement : six films en deux ans !), la série des Baby Cart n’en demeure pas moins une illustration glorieuse d’une certaine idée du cinéma, à son apogée à l’époque où les films sont produits : triomphe de l’auteur, et partant, de la mise en scène considérée comme seule valeur du film. Pour qu’on lui tresse ses lauriers, Misumi va cueillir bien des fleurs de sang. Car dans un Baby Cart, on y vient pour elles, ce sont les scènes d’affrontement qui comptent. Et qui stupéfient.
Le chambara tirerait son nom du son produit par la chair que tranche l’acier : cham-cham-bara-bara. C’est bien souvent la seule musique accompagnant les baroques duels opposant Itto Ogami à ses adversaires. Les films étant par ailleurs très brefs (autour des 80 minutes) et les metteurs en scène préférant laisser parler leurs cadrages ayant la beauté de l’évidence plutôt que de faire systématiquement appel à une musique pressant sur le bouton émotionnel correspondant, le disque produit par La-La Land Records, malgré une apparente brièveté, propose en fait une approche très représentative des scores des six films, dont chacun est représenté sur le disque organisé chronologiquement. La traversée n’est pas de tout repos.
D’entrée de jeu, ce qui frappe est l’usage insolite que Kenji Misumi, en vieux renard sûr de son style, fait du silence. Dans Sword Of Vengeance (Le Sabre de la Vengeance) plus que dans n’importe quel autre épisode de la saga, l’hypothétique tentation d’une musicalité débordante est dévorée par des blancs d’une texture opaque, presque palpable : le bruissement du vent dans les hautes herbes s’évanouit, le vacarme d’une pluie diluvienne est réduit à rien, les lames sont tirées hors du fourreau sans un soupir. Ainsi cantonnée à de parcimonieuses apparitions, la musique de Sakurai ne s’aventure à rompre ce silence assourdissant que pour nimber certains moments-clés, chuchotant et suggérant plutôt que surlignant à traits criards. Le shakuhachi et les pizzicati de cordes sont les porte-paroles lancinants de l’inflexible détermination d’Itto Ogami, qui offre à son tout jeune fils Daigoro, dans The Ball And The Dotanuki, le choix entre une fin miséricordieuse et une errance maudite. Le théâtre nô n’est pas loin, et c’est encore son minimalisme à la fois lyrique et foncièrement intériorisé qui s’incarne dans la flûte solitaire de The Bird And The Beast, où le héros fait montre de sa profonde noblesse envers une prostituée aux abois.
Ce pourrait n’être là qu’une (belle) concession à un folklore japonais ancestral s’il n’y avait ce bien curieux gimmick que Sakurai exploite à satiété : la réverbération prononcée par laquelle passe tout l’instrumentarium, distendant le phrasé musical à la manière d’un écho fantomatique. Un zeste d’expérimentation qui ne dépareille pas avec l’audace du désormais fameux Main Title, sans doute la contribution la plus essentielle du compositeur au mythe écarlate de Baby Cart. Si les excès cinglés de Misumi et la silhouette dépenaillé du Loup à l’Enfant n’avaient pas déjà été suffisamment éloquents, les quatre notes scandées telle une sombre litanie par la guitare électrique auraient tout dit du réjouissant anticonformisme de la série. Véritable signature appelée à surgir au générique de chaque nouvel opus, ce thème tempétueux niera un peu plus encore le legs classique du chambara dès l’inévitable suite, Baby Cart At The River Styx (L’Enfant Massacre), qui le lestera de courtes rafales cuivrées et de percussions toujours plus endiablées. Comme pour mieux accompagner le père et le fils dans l’enfer bariolé d’un cinéma jamais repu de spectaculaires embardées visuelles…
Et dans le domaine, Baby Cart At The River Styx plante si haut le drapeau écarlate qu’aucun des autres films de la série ne viendra le décrocher. Succession de séquences déchaînant un imaginaire sanglant méritant pour toute décoration une camisole de force, le second film de Misumi fait un usage plus qu’économe de la musique, d’autant plus qu’elle est souvent intra-diégétique. Ainsi, des gongs et des clochettes annoncent dans différentes séquences une menace d’abord invisible puis matérialisée lorsque les instruments apparaissent à l’écran, entre les mains des différents assassins tentant vainement d’entraver la route du landau sanglant. On assiste donc à l’attaque des amazones ninja du clan Yagyu, d’abord déguisées en artistes acrobates, s’accompagnant de petits tambours. Ensuite grimées en paysannes, elles entonnent une litanie destinée à hypnotiser Ogami le temps de frapper. Ce beau thème de la musique devenant dans la bouche des personnages un chant des sirènes inspire à Misumi une autre très belle séquence, lorsqu’une le son d’une flûte éveille la curiosité de Daigoro au point de lui faire quitter le chevet de son père blessé. La jolie mélodie se double rapidement de percussions martiales, associées aux assassins et sonnant comme un glas, puis de tambours qui, en apparaissant à l’image, ne laissent plus de doute : Daigoro est tombé dans le piège tendu par la musique. Difficile de rêver plus belle association de la musique et de l’image dans un chambara.
Ce thème du chant des assassins trouve sa conclusion lorsque Ogami et Daigoro, transis de froid, se réfugient dans une cabane avec la seule survivante du clan des amazones Yagyu. La sirène est cette fois prisonnière et lorsque Ogami la dénude pour la forcer contre lui, on s’attend à ce que sa supériorité s’exprime cette fois par la contrainte de sa virilité. Mais lorsque Daigoro est joint au couple, on comprend sa véritable intention: le trio doit se réchauffer ou mourir de froid. Les flûtes associées aux femmes Yagyu entonnent leur mélopée, relayées à l’image par la main de Sayaka cherchant sa lame, toujours décidée à tromper la vigilance d’Ogami. Mais Daigoro, jouant avec son téton dans un geste mi-cruel, mi-instinctif, bouleverse la femme qui renonce à son projet. Les flûtes se développent, les percussions martiales ne viendront plus les troubler. La musique, pudiquement, magnifie un des rares moments de tendresse de la série. C’est la musique de cette séquence, The Ogamis And Sayaka Yagyu, que l’on retrouve sur le disque et qui est le seul extrait retenu, qui témoigne de cette approche pointue du rôle confié à la bande originale dans Baby Cart At The River Styx qui, pour être quantitativement réduite, n’en demeure pas moins essentielle à l’expression du récit. Seules quelques percussions de Bentenrai The Public Guard rappellent l’approche intra-diégétique dans les quelques mesures suivant l’ouverture rythmées par des tambours sonnant comme un glas.
L’approche de Bentenrai The Public Guard et de Duel At The Sun est plus illustrative : mélange de percussions plus ou moins fortes en rafales très rapides et de ribambelles de flûtes plus ou moins syncopées et mélodiques. La structure percussive est reprise et accueille différentes variations instrumentales pour illustrer quelques-uns des affrontements des films suivants : The Wolf Howls In The Wilds dans Baby Cart To Hades (Dans la Terre de l’Ombre), Besieging Army Of Ura Yagyu dans Baby Cart In Peril (L’Ame d’un Père, le Cœur d’un Fils), et The Kuroda Mendo Army ou The Running Wolf pour Baby Cart In The Land Of Demons (Le Territoire des Démons). Sur cette rythmique, les musiciens de Sakurai semblent se laisser aller à l’improvisation au gré de leurs envies mélodiques et instrumentales, leurs dissonances erratiques contrastant avec les cadrages hiératiques d’adversaires s’affrontant dans des échanges aussi brefs que meurtriers. Il faut voir dans ces différentes reprises et variations des bornes indispensables et des signatures bienvenues car les musiciens de la saga, par ailleurs trop heureux qu’on leur défasse la laisse, vont parfois partir dans tous les sens et proposer des associations musicales dont le seul horizon semble être la recherche du collage le plus incongru.
On s’explique d’autant mieux, à la lueur de telles outrances faisant profession de foi, le maigre enthousiasme suscité par l’excellent Baby Cart To Hades. Pris en tenailles entre l’ivresse stylistique de ses prédécesseurs et les œillades toujours plus référentielles des chapitres à venir, le film patiente en effet jusqu’à sa dernière bobine pour payer son dû à la trademark sanglante de la série. Reconnaissons-lui toutefois dans l’accomplissement de cette besogne un zèle inouï, comme une tentative assumée (et accomplie à la perfection) de se mesurer à l’extravagance si souvent conspuée du western latin. Tandis que tonitrue l’habituel arsenal sonore de Sakurai, Ogami, pareil au Franco Nero mitrailleur de Django, fauche des dizaines d’adversaires grâce au landau de son fils, que l’on découvre hérissé de canons meurtriers. Ce faisant, The Wolf Howls In the Wilds le marque d’une estampille nouvelle : un thème aux bourrelets héroïques un rien pompiers, qui exaltera bien d’autres carnages surréalistes jusqu’au terme de la saga.
Mais ces cuivres ruisselant à gros bouillons ne sont qu’illusion. Au lieu du chambara survitaminé qu’aurait pu (dû) engendrer le fulgurant succès de Baby Cart At The River Styx, ce troisième opus s’abîme dans de contemplatives langueurs, parsemées de petites tranches de vie donnant à voir l’autre destin plus paisible que le Loup désire secrètement pour son fils. Magnifiée avec une sensibilité toute japonaise par le maniérisme pictural de Kenji Misumi, la nature dévoile ses richesses foisonnantes en même temps que deux fugues douce-amères, un Shining Waters frémissant de cordes et le fragile Daigoro At A Rainy Night, qu’une flûte éthérée cajole avec douceur. Les délires grand-guignolesques auxquels Baby Cart est communément réduit paraissent lointains ; d’ailleurs, face aux exactions ignobles dont les hommes n’hésitent pas à souiller ce cadre édénique (le double viol perpétré par des mercenaires enragés), la partition observe un silence de mort. Celui-là même dont Misumi a su se faire un allié au moins aussi précieux que le melting-pot musical de Sakurai.
Après avoir ôté la vie à celui qu’il considérait comme «un vrai samouraï», Ogami reprend la route en abandonnant derrière lui ses commanditaires épouvantés, convaincus que sous sa prodigieuse invulnérabilité se cache un démon étranger au monde des hommes. Et il se pourrait qu’ils n’aient pas tort… Tel est en tout cas le sentiment qui se dégage de la chanson finale, où l’interprète d’Ogami en personne, Tomisaburo Wakayama, entonne de sa voix gutturale plusieurs couplets retentissants. Il y est question de violents trépas, d’un sinistre corbeau et de la venue du Dieu de la Mort. Ce dernier, évidemment, aura de nouveau un considérable ouvrage à abattre dans Baby Cart In Peril. Mais l’entrain ne faiblira jamais, comme l’atteste d’emblée la coutumière et très énergique reprise du Main Title.
En fait d’enthousiasme, à dire vrai, c’est peut-être une salvatrice injection de sang neuf qui manque à ce quatrième volet. Misumi ayant cédé la barre au très capable mais assurément pas génial Buichi Saito, l’exceptionnel degré d’exigence formelle de la série se trouve jugulé par une mise en scène aussi carrée que dépourvue de folie baroque. A son pupitre, Sakurai broie visiblement du noir, comme si l’invention torrentielle du cinéaste, maintenant enfuie, avait toujours représenté le principal terreau de sa propre inspiration. Le voici donc occupé à recycler à la louche ses scores précédents, les convoquant en une sorte de best of scolaire qui se préoccuperait moins des mélanges délicieusement impurs des débuts que des confortables habitudes des fans du Loup à l’Enfant. Besieging Army Of Ura Yagyu, qui sacrifie à l’incontournable séquence de combat à un contre cent, dévide ainsi durant presque cinq minutes pleines à craquer tous les trucs de Baby Cart en matière d’action mouvementée. Strophes enfiévrées de cuivres belliqueux, percussions roulantes, flûtes aux stridentes ondulations… Dans cet inventaire voulu exhaustif, le compositeur n’a pas oublié de mettre en exergue les trompettes héroïques entraperçues lors de Baby Cart To Hades, qui sont cette fois encore annonciatrices d’une mort imminente pour les ennemis de notre mutique ronin. Et ce dernier, à l’instar du scrupuleux Sakurai, de s’acquitter de son macabre labeur avec une efficacité parfois mécanique, certes, mais jamais exempte de professionnalisme.
Tout aussi mécaniques les deux morceaux de bravoure de Baby Cart In The Land Of Demons, The Kurodo Menbo Army et The Running Wolf, déjà évoqués plus haut et complétés par Setting Sun, illustrent de manière plutôt conventionnelle leurs scènes de combat ou le sprint anthologique d’un Ogami enroulé dans un maillot blanc, propulsé autant par sa bedaine que par ses jambes. On aurait tort d’en rire. Car Misumi, de retour à la barre, est capable d’illustrer avec le sérieux le plus impérial les idées les plus cartoonesques. Qu’on en juge : Ogami, dont c’est la seule opportunité pour pouvoir remplir un contrat, doit frapper sa cible, un prêtre qui traverse un fleuve en barque sous bonne escorte. Impossible n’est pas Itto ! Armé d’une sorte de compas à couteau et d’une tige de roseau, il nage sous le fond du bateau de sa victime, à l’insu du regard de tous, et taille tranquillement un rond juste sous le fauteuil du prêtre ! La découpe achevée, le saint homme dégringole dans l’eau, exactement comme Porky le ferait dans n’importe quel cartoon de Bugs Bunny. La bande musicale, qui pourrait à cet instant se garnir de pouet-pouets et d’un bon coup de klaxon reste parfaitement muette. C’est que Misumi est décidé à mégoter encore plus que de coutume sur l’illustration mélodique. La bande-originale sert surtout ici, à ponctuer des fins de scènes, par des giclées de flûtes ou de cuivres de quelques secondes, trop brèves pour figurer sur le disque.
Mais Sakurai a encore quelques flèches à tirer avant de passer le relais pour l’épisode suivant, et nous cueille avec un ultime métissage: ce The Wolf’s Cub, qui pourrait illustrer le générique d’un giallo transalpin de la même année. Dans le film, la mélodie accompagne Oyo, pickpocket repentante qui se dénonce aux autorités pour épargner au jeune Daigoro les sévices dont on le menace s’il ne désigne pas dans la foule la criminelle. Inutile de dire qu’il en faut plus pour impressionner le fils du Loup, qui endurera sans une grimace la flagellation qu’on lui infligera tout de même. En une minute, quelques bois rêveurs posés sur une rythmique entêtante de cordes pincées suffisent au musicien pour évoquer la tendresse amère de la femme pour l’enfant. A moins qu’il n’illustre ce gros plan, pourtant silencieux, concluant la scène, cadrant la main de Itto serrant celle de son fils, rare illustration de «l’impitoyable tendresse» (selon la belle expression de David Martinez, concepteur des DVD de la collection HK) unissant le père et le fils.
C’est à Kunihiko Murai de conclure la saga. Sa collaboration régulière avec Shintaro Katsu, frère de Tomisaburô Wakayama – l’interprète d’Ogami et producteur du film – explique sans doute son embauche. Le générique retenu pour le disque entérine le basculement pop de la série. Transformé en 007 du japon médiéval, Ogami pourrait presque bénéficier d’une chanson titre. Son faciès, nettement moins aguicheur que ceux de Richard Roundtree ou Fred Williamson, aurait-il pu orner la pochette d’un 45 tours bariolé ? Murai n’en doute pas une seconde en ciselant un Main Title bien groovy qu’on jurerait échappé de la discographie de Lalo Schifrin ou des chutes de studio de Shaft. Bonbon pop imparable, c’est la fanfare d’adieu idéale pour saluer la série des Baby Cart qui, en s’achevant musicalement à quelques sillons de la déferlante blaxploitation, aura, mine de rien, parcouru tout ce que le cinéma populaire pouvait offrir de formellement excitant à l’époque. Qu’un personnage qui n’a pas décroché un sourire en huit heures de projection se voit gratifié de presque trois minutes de ronronnements aussi sexy qu’un single de Curtis Mayfield témoigne de l’insolente liberté formelle qui gonflait les poumons d’un cinéma populaire nippon ignorant qu’il se préparait, pourtant, à rendre son dernier souffle.
Mais pour l’heure, triomphant, le sabre de la vengeance rentre dans le fourreau une ultime fois. Itto Ogami, invaincu, pousse le chariot de Daigoro. Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour le cinéma. En six films, le sabreur à l’enfant est entré dans la légende. Au fil des ans, par la grâce d’éditeurs éclairés, la série des films s’installe dans le cœur des cinéphiles et dépasse largement le cercle des amateurs de chambara. Si elle est tardive, la compilation de La-La Land demeure le témoignage essentiel du contact des sanglants et baroques photogrammes de Misumi, Saito et Kuroda, avec le talent des compositeurs Hideakira Sakurai et Kunihiko Murai. Et le choc nous envoie de sacrées étincelles, propageant le feu depuis les cendres de la musique traditionnelle japonaise jusqu’aux beats imparables d’une soul cinématographique en provenance des quartiers noirs américains. Une pérégrination qu’Ogami accomplit placidement, une main sur le manche de son sabre, l’autre sur le landau où s’endort son fils Daigoro. Mortelles berceuses !
















