 HARD-BOILED / LAT SAU SAN TAAM (1992)
HARD-BOILED / LAT SAU SAN TAAM (1992)
A TOUTE ÉPREUVE
Compositeur : Michael Gibbs
Durée : 63:11 | 17 pistes
Éditeur : Mute Records
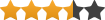
S’il existe une pièce pourtant majeure de l’échiquier cinématographique mondial que les amateurs de musique de film, même les plus friands de curiosités, tiennent pour denrée négligeable, c’est sans conteste Hong Kong. Pareille sentence, d’un goût de cendres pour une poignée de compositeurs aux efforts méritoires et parfois brillants (James Wong, Joseph Koo, Chan Kwong-wing), pourrait laisser le sentiment d’une injustice terrible. Mais à dire vrai, on ne voit guère quelles circonstances atténuantes accorder à une industrie dont les horizons, depuis la fin des sixties, se partagent presque exclusivement entre d’ignobles pâtés électroniques et la récupération tous azimuts des succès musicaux d’outre-Atlantique. Le temps passant, les spectateurs locaux ne s’étonnèrent plus de voir les épéistes vindicatifs du wu xia pian défaire des vagues d’ennemis sur les mélodies ciselées des 007 de John Barry, et ne haussèrent pas même un sourcil interloqué en découvrant que les gesticulations des piètres clones de Bruce Lee étaient flanquées du thème groovy de Shaft. John Woo, qui préparait à la fin des années 80 le mythique The Killer, en fut ainsi réduit à essuyer douloureusement les plâtres : lui qui rêvait d’enrober son polar désenchanté de langoureuses mélodies jazzy dut s’accommoder, bon gré mal gré, des chansons foncièrement chinoises de son actrice principale Sally Yeh et du pillage quasi-intégral de la musique de James Horner pour Red Heat. Mais quelques années plus tard, Hard-Boiled, le film-testament de sa carrière hong-kongaise, allait être l’occasion pour le cinéaste de prendre une douce revanche.
Plus encore qu’un baroud d’honneur qu’il souhaitait titanesque en terre natale, ce dernier essai avant son départ pour Hollywood était l’occasion pour lui de prouver qu’il pouvait parfaitement adopter une certaine sensibilité occidentale que la cinéphilie vorace de ses jeunes années lui avait de toute façon rendue très tôt familière. D’où les multiples accointances du résultat avec les blockbusters tonitruants usinés par l’Oncle Sam, entre une débauche pyrotechnique rarement vue à Hong Kong et des ficelles narratives que Woo, parfois, prend un facétieux plaisir à détourner. Mais cet exercice d’émulation artistique, avait-il décidé, ne pouvait décemment se passer d’un minimum de sophistication musicale. Rechignant à puiser une fois encore de larges portions d’une œuvre déjà existante (même si l’on reconnaîtra sans peine, lors du célèbre plan-séquence dans les couloirs de l’hôpital, les étouffantes percussions tribales de Predator 2), tout aussi incapable de se résoudre aux ignominies Bontempi bâclées par ses compatriotes, le réalisateur finit par s’adjoindre les services de Michael Gibbs, un musicien polymorphe qui, loin des plateaux de cinéma auxquels il ne s’est que sporadiquement intéressé, a toujours préféré traîner ses guêtres parmi les jazz-bands. Il suffit pourtant que le frénétique Hard-Boiled Overture dévide ses notes liminaires pour comprendre que c’est justement cette singularité qui a valu à Gibbs d’être propulsé en première ligne. D’emblée, synthétiseurs et saxophone se posent comme les soubassements en l’absence desquels la partition se volatiliserait en poussière. Ils s’effleurent et se caressent avec une nonchalance affectée, comme un reflet de la mélancolie qui irrigue secrètement le film, pour mieux, l’instant d’après, s’entrechoquer avec une furieuse hargne rythmique, à l’unisson des incroyables orgies de destruction orchestrées par un John Woo au zénith de sa virtuosité formelle.
Hard-Boiled, à cet égard, a maintes fois été présenté comme une version sur-vitaminée de Lethal Weapon (L’Arme Fatale) via des raccourcis critiques certes un peu faciles, mais pas dénués de fondement. Un constat qui s’explique sans mal, grâce au tandem de flics antagonistes et gouailleurs que forment les charismatiques Chow Yun-fat et Tony Leung Chiu-wai, bien sûr, mais aussi par l’omniprésence du saxophone dont les traits tantôt chaleureux, tantôt atmosphériques et lancinants, réussissent à évoquer de loin en loin le classique de Michael Kamen, toujours très populaire en cette année 1992. A l’instar de son regretté confrère, Gibbs use du timbre si caractéristique de son instrument pour l’introniser émissaire d’une large gamme de sentiments, en particulier ceux qui taraudent l’infortuné Tony et prennent tour à tour possession de lui. Aux yeux de tous, il est le jeune truand tout en décontraction féline qui sillonne les rues de Hong Kong au volant de son coupé sport dans l’insolent Red Car Boogie. A l’abri des regards, ne reste plus que le désarroi d’un policier sous couverture, devant sans cesse jongler avec deux identités antithétiques et rêvant à un ailleurs baigné de lumière dont la pureté s’incarne à travers le ton mélancolique et les tintements cristallins de Yuen And Kong. C’est cette même tristesse qui mouchette Sad Kong de pointes diffuses, nuancée, cette fois-ci, de douloureux accents tragiques : responsable de la mort du pygmalion qui lui avait accordé sa confiance et son estime, Tony se sent vaciller plus que jamais au bord du gouffre.
Une dualité identique confère leur inspiration aux nappes électroniques dont Michael Gibbs fait un emploi extensif. Dans Wong-Kong, elles dégagent une froideur clinique, presque reptilienne, pour donner corps à la menace du redoutable Johnny Wong (à qui l’acteur Anthony Wong, alors abonné aux rôles de psychopathe ultra-violent, prête son rictus moqueur), tandis que le saxophone, sans doute parce qu’il rappelle finalement davantage le couple de héros, ne parvient à faire entendre que des échos étouffés. Mais ailleurs, les synthés soudain assagis offrent à John Woo l’occasion d’illustrer l’un de ses thèmes récurrents, qui voit l’innocence immaculée d’un enfant brutalement projetée dans un tourbillon de flingues et de violence baroque. Ici, c’est le tough cop Tequila qui tente de s’interposer, au cours d’un bref échange de coups de feu que berce le paisible Shirley And The Babies, douce mélodie aux allures pour le moins inattendues de comptine.
Que les amateurs d’action féroce soient rassérénés, cette façon singulière d’accompagner les outrances visuelles du film demeure un interlude sans suite au sein d’un florilège de percussions diverses (où les timbales se taillent la part du lion), d’ostinati synthétiques saisis de fièvre et des vociférations de l’inévitable saxophone. Ce dernier, lors du court mais très ramassé Boatyard Battle, fait d’ailleurs efficacement écho au vacarme des détonations en suivant un tempo tout en saccades subites. Mais la pièce maîtresse de Hard- Boiled en la matière reste à n’en pas douter Hospital Inferno, ne serait-ce que pour sa durée peu commune : treize minutes, rien de moins, voulues comme un immense morceau de bravoure à la hauteur du carnage extravagant qui embrase l’écran. Treize minutes durant lesquelles Michael Gibbs revisite et condense une bonne partie de son ouvrage textural, au risque de bégayer les formules de style déjà copieusement usitées plutôt que de leur injecter une salutaire dose de sang neuf. Du coup, si le spectateur abasourdi encaisse comme autant d’uppercuts meurtriers les folles idées chorégraphiques d’un John Woo déchaîné, l’auditeur, pour sa part, peut sentir poindre ça et là une certaine monotonie, fort heureusement contrebalancée par le monologue trépidant du saxophone qui, entre les mains habiles du compositeur, démontre une inventivité toujours renouvelée. Il est à lui seul le garant de l’intégrité musicale de Hard Boiled, le fluide vital qui fait battre son cœur, caché sous un déluge de balles, et la clef qui ouvre sur l’indicible amertume que l’on devine dans les profondeurs du regard d’un flic défait.













