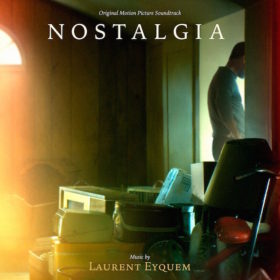Natif de Bordeaux, Laurent Eyquem débute sa formation de pianiste classique à l’âge de six ans. De nombreuses années d’études, de premiers prix et une passion pour le cinéma et ses musiques le mènent très logiquement à la composition pour l’image. Toutefois, avant de mettre ses talents au service du septième art, Laurent réalise un rêve : celui de consacrer quelques années de sa vie à des organisations humanitaires internationales. Après ses débuts acclamés pour le film québécois Maman est chez le Coiffeur de la réalisatrice Léa Pool, Laurent devient en 2013 la Découverte de l’Année décernée par l’IFMCA (International Film Music Critics Association). Les cinq années qui suivent le verront enchainer à un rythme soutenu films et séries télévisées, de l’action (Tokarev, Rabid Dogs, Momentum) au drame historique (Winnie Mandela, Copperhead, USS Indianapolis, Clash Of Futures: 1918-1939) en passant par des projets plus intimes (Nostalgia). C’est à l’occasion du Festival du Film de Gand, où il a justement remporté le Public Choice Award pour la partition de ce dernier, que nous l’avons rencontré pour évoquer une carrière en forme de grand écart entre l’Europe et les États-Unis.
Te souviens-tu de ton premier souvenir musical en rapport avec le cinéma ?
Oui, je me souviens d’avoir vu des films avec des musiques de Vladimir Cosma comme La Chèvre, je devais avoir 11 ans, et de revenir à la maison après le film, de me mettre au piano et de jouer d’oreille tous les thèmes de La Chèvre. Je suis devenu très vite un fan de Cosma, pour cette gaieté qu’il amenait dans les musiques et après ça, comme tout le monde, j’ai grandi avec Jean-Michel Jarre, tous ses albums, Equinoxe… Il a amené la mélodie dans l’électronique, ce qui était assez nouveau. Et bien sûr Maurice Jarre, Jean-Claude Petit, toutes les personnes avec qui j’ai voyagé musicalement jusqu’à mon départ.
Le piano, c’est ton instrument de prédilection ?
Oui. En fait, c’est assez particulier, je ne travaille pas tout à fait comme beaucoup de mes collègues. Certains vont s’asseoir au piano, ils vont essayer quelque chose, une mélodie, et ils vont penser : « Tiens, si on rajoute cette partie-là… » ou quelque chose comme ça. Moi, il faut que j’aie un piano, je vais penser à une scène, une émotion, et d’un seul coup quand la musique vient, pour moi elle me vient entièrement dans la tête. C’est-à-dire que j’entends les parties de tout l’orchestre. C’est plus une course contre la montre. Des fois, ma femme va me voir disparaître pendant six ou sept heures. Je vais laisser le lave-vaisselle ouvert alors que j’étais censé le vider et puis elle revient deux heures après et me demande « Qu’est-ce qui s’est passé ? » C’est la farce constamment entre nous. En fait c’est une course contre la montre pour moi de remettre vite sur papier ou sur les banques de sons la partie de contre-mélodie, le contrepoint de clarinette, les divisions violons… Parce que j’entends la musique dans son ensemble. Ce qui est pour moi un avantage : j’écris extrêmement rapidement, même pour les standards de Los Angeles. Mais c’est aussi un inconvénient parce qu’il y a certains réalisateurs qui ont travaillé avec des musiciens plus que des compositeurs et qui vont être habitués à s’asseoir à côté et de dire « Ah ben, tiens, si on essayait ça, ou si on faisait ça ? » Ils sont un peu surpris quand je leur dis : « Je ne marche pas comme ça. Donne-moi 24 heures. Je te promets, dans 24 heures tu vas être agréablement surpris. » Notre processus d’échange va plus être basé sur les émotions et moins sur « Tiens, on va essayer ça avec cet instrument ou cet autre. » Mais ça commence par le piano, obligatoirement.
Dans une interview en 2010, tu disais te sentir apatride, entre Bordeaux, Québec et Los Angeles…
Ça reste toujours le cas… Depuis le temps que j’ai quitté la France en 1993, elle a évolué (rires). Même si j’ai de la famille, quand je reviens, ce n’est plus forcément la France dans laquelle j’ai grandi ou que j’avais connue. En même temps je vis aux États-Unis : c’est un monde, une culture bien particulière. Je l’apprécie mais j’essaye de garder toujours mes valeurs françaises, les valeurs avec lesquelles j’ai grandi, qui sont plus des notions latines sur la famille, sur nos valeurs en tant que personnes… Tout cela fait en sorte, effectivement, que j’ai toujours ce sentiment apatride. J’essaye de prendre ce qu’il y a de meilleur pour moi dans chacun des pays. Je reviens souvent en France, en Europe, pour le travail, donc je peux me replonger dans notre monde, me ressourcer, et puis repartir continuer aux États-Unis.
Tes choix sont très contrastés, on passe d’un film d’action à un film intimiste… C’est volontaire ?
Oui. Ma case de prédilection, c’est les films intimistes, j’aime les drames, comme je travaille essentiellement sur des émotions, ça me permet de transcrire beaucoup plus de choses que dans un film d’action où tout va exploser et où il faut maintenir le spectateur assis au bord de son siège, et où les techniques sont toujours à peu près les mêmes. Et puis c’est difficile maintenant de passer des thèmes dans les films d’action. On m’en propose pas mal, mais j’essaye dès que je peux de prendre ici et là un bon film, un drame, parce que pour moi c’est là où je suis le plus connecté. Je n’aime pas forcément ce que j’écris pour les films d’action. Ce n’est peut-être pas pour moi mon approche directe, dans le sens de quelque chose que je fais naturellement. Mais c’est marrant, parce que je reçois des e-mails de gens, même pour le film Tokarev, et je vois des personnes mettre des choses sur YouTube, une personne qui m’envoie un message me disant « Je rentrais dans le cinéma, je ne savais pas quel film se terminait mais j’adorais le thème et je me suis dit qu’il fallait absolument que je me trouve la B.O. » Et ça me surprend, parce que sur les films d’action, j’ai l’impression de moins toucher les gens que sur un drame.
Parlons un peu de Copperhead, où on trouve justement ce sens du drame, de la tragédie…
Ça fait partie des beaux cadeaux de la vie. Quand j’ai fait mon premier film, Maman est chez le Coiffeur, Léa Pool, qui a travaillé avec de grands compositeurs, m’a dit : « Mon film, c’est ton film à partir de maintenant. » La même approche s’est passée avec Ron Maxwell. J’avais beaucoup de pression, Ron Maxwell est connu pour avoir fait le plus grand film de l’histoire américaine sur la guerre civile, Gettysburg, qui est LE film référence, avec Randy Edelman qui avait fait le score… Donc j’avais beaucoup de pression ! Mais en fait, quand j’ai rencontré Ron au festival de Toronto, il avait visionné Winnie Mandela, que j’avais fait, il est venu me voir et m’a dit : « Laurent, j’aime beaucoup ce que tu as fait, comment tu as géré les mélodies et les émotions sur Winnie Mandela. J’ai un film sur la guerre civile qui est différent, il n’y a pas de bataille. C’est le premier film sur la guerre civile où on parle de ce que les gens ont vraiment pu ressentir, comment ça a pu déchirer les familles, entre les républicains et les démocrates. » Il m’a donc envoyé le script. J’ai écrit le thème en avance, parce qu’il y avait une ou deux chansons qu’il voulait mettre sur mes thèmes. J’ai eu complètement carte blanche de Ron là-dessus, et il m’a donné de belles images. Au fur et à mesure, quand j’ai commencé à composer, il m’a appelé pendant le tournage et m’a dit : « Laurent, on coupe des scènes de dialogues parce que je n’en ai pas besoin avec ce que tu es en train d’écrire. Est-ce que tu peux me faire cette pièce-là pour cette partie-là ? Je sais que tu vas nous faire vivre autant d’émotion que s’il y avait un dialogue entre ces personnages. » Il a donc même coupé des dialogues du film pour le laisser respirer et laisser la place à la musique. C’est donc ma vision à moi du temps de la guerre civile, c’est ma musique à moi sur cette période-là.
Momentum est un score intéressant, avec un mélange audacieux d’électronique et d’orchestre ?
J’ai enregistré à Abbey Road avec un orchestre symphonique. Je pense que j’avais 55 cordes. Violons, altos, violoncelles et contrebasses, on avait du monde. Et spécialement quand on a beaucoup d’électronique derrière, il faut du volume. C’était un défi. La première pièce de musique que j’ai écrite, c’était la course-poursuite dans le parking. Quand elle vole la voiture et qu’elle part à reculons. Ça m’a donné toute l’idée pour le film : retravailler le son et de le mettre complètement à l’envers. J’ai écrit la partie d’orchestre tout de suite, avec les violons qui montent, qui montent jusqu’au moment où elle descend et puis on a un grand coup de frein. Et à ce moment-là, les violons sont au maximum de ce qu’ils sont capables de faire et au moment où il y a le coup de frein, toutes les notes de violons sont complètement renversées, à l’envers, pour donner cet effet d’aspiration dans le temps, qui s’arrête complètement. J’ai utilisé ça après pour les percussions, j’ai pris beaucoup de percus et j’ai fait beaucoup d’effets. Mettre à l’envers toutes les percussions, utiliser leur réverbération et commencer par ça, ce qui fait cet effet de mouvement saccadé.
Tu arrives à visualiser à l’avance ce que ça va donner quand tu retravailles en profondeur ?
Oui, parce que dans ma tête je sais exactement comment ça va sonner. Le plus difficile quand j’enregistre après, c’est d’arriver au résultat que j’ai dans la tête, parce que je l’ai entendu comme joué par les meilleurs musiciens au monde, donc tout est parfait ! Après, le travail c’est juste de corriger les imperfections. Quand on enregistre, quand ce sont comme ça des mouvements très rapides, ça prend beaucoup d’enregistrements, de réenregistrements, refaire, refaire, et après on va couper juste de telle mesure à telle autre. Parce que quand vous avez cinquante musiciens et que c’est une double croche sur des tempos extrêmement rapides, le moindre retard de n’importe quel musicien, on va l’entendre, et d’un seul coup ça fait flou, ça n’a plus l’aspect extrêmement précis. Il y a beaucoup de changements de tempo, c’est donc beaucoup de travail en direction d’orchestre aussi, quand je travaille avec les musiciens. Il faut qu’ils me suivent rapidement. Ils doivent apprendre la partition sur le moment, et il y a en plus tous les changements aléatoires, les syncopes… C’est intense.
Est-ce que c’est un moment particulier pour toi l’enregistrement, là où la musique devient vivante ?
Oui, en fait pour moi, le seul rapprochement que je pourrais faire c’est que c’est comme la naissance d’un enfant. C’est-à-dire que vous l’avez espéré, vous l’avez imaginé… Dans ma tête, je sais exactement comment ça devrait arriver, parce que c’est arrivé comme ça d’un seul coup. Ça a été écrit comme ça. Et il y a toujours pour moi un moment magique, dans les deux minutes avant le commencement officiel sur le chronomètre des heures de travail, où je suis au pupitre, je prépare mes partitions, et là les musiciens quand il s’échauffent, chacun joue une petite phrase qu’ils ont devant eux, et ça sonne comme tout orchestre qui s’échauffe, ils n’ont aucune idée de comment la pièce va sonner dans quelques secondes, quelle est la mélodie… Ils ont une ligne et d’un seul coup en quelques secondes, tout le monde part ensemble et tout le monde découvre finalement la mélodie puis la musique qui est là, qui naît, et qui était celle que vous avez imaginée pendant des semaines, et ça, c’est un moment magique.
C’est assez fantastique de pouvoir tout visualiser à l’avance…
C’est aussi le problème parfois : j’essaye de ne pas commencer trop à l’avance parce que c’est comme un robinet que vous ouvrez. L’eau coule. Il y a parfois des journées où avant que le film ne commence, je ne veux pas y penser parce que sinon là tout de suite j’ai des mélodies ou des musiques qui arrivent, et donc je veux vraiment me concentrer sur le moment où je suis sur le film. Mais, en même temps, ma compagnie aux États-Unis s’appelle Nuntius Productions, et nuntius en latin veut dire « messager », parce que j’ai plus l’impression d’être un messager qu’un compositeur, comme les musiques viennent dans ma tête… Quand j’étais jeune compositeur et que j’imaginais ce que c’était, je voyais l’écriture : on essaye ceci et puis on rajoute ça, etc… Et je ne suis pas comme ça. J’ai donc plus l’impression d’être un robinet qu’on ouvre. Je me mets sur une émotion, sur une scène, et puis « poum ! », d’un seul coup ça arrive. Et puis forcément, tous les films ne vont pas ouvrir le même robinet et amener la même passion, la même émotion non plus…
Comment est-ce que tu travailles avec tes orchestrateurs ?
Comme la musique me vient dans la tête, j’écris et j’orchestre tout à 99,9 %. Alors après ça, on est parfois restreints par des délais fous. Quand j’ai fait la série The Red Tent pour Sony, passé sous le titre La Fille du Désert en France sur TF1, là j’ai eu trois semaines pour écrire, orchestrer, enregistrer et mixer 120 minutes de musique orchestrale. C’était donc 20 heures de travail par jour pendant trois semaines. Normalement, sur les films j’écris toutes les parties, je les transfère à mon orchestrateur qui me prépare ma version de chef d’orchestre, pendant que j’écris la prochaine pièce. Je corrige, je mets mes annotations, on les valide, et à ce moment-là c’est envoyé au copiste qui lui va préparer toutes les partitions individuelles pour tous les pupitres. Pendant ce temps également, tout est transféré à mon ingénieur pour préparer chaque session pour chaque morceau, avec les time-codes, les images, les notes : combien on doit faire de prises, etc… C’est un gros travail d’équipe.
Comment est-ce que tu gères la musique temporaire, quand il y en a ?
D’une manière très simple : je la mets sur mute (rires). Je déteste… Mais ça dépend, je vais vite jauger si le réalisateur va être plus qu’attaché à sa musique temporaire. Il y a aussi certains monteurs qui sont difficiles, parce qu’ils deviennent les « réalisateurs fantômes », comme je les appelle. Ils ont passé tellement de temps ensemble dans la salle de montage que parfois le monteur a donné toutes les idées de musiques et les deux sont persuadés que c’est absolument ça qu’il faut. Ce que je fais quand je m’aperçois qu’on s’en va comme ça, c’est que je vais passer la plus grosse partie de mon temps sur la première bobine et je vais décomposer mathématiquement la structure des pièces musicales que le monteur a mises sur chacune des scènes. Où est-ce qu’il y a des changements, quel est le tempo de cette pièce… Je refais une trame mathématique avec les changements de tempo, les vitesses, pour comprendre ce qui l’a motivé – souvent, il aura monté les images sur la musique temporaire. Je recrée une musique qui correspond mathématiquement exactement à la musique temporaire mais qui n’a rien à voir. Là, je mets le monteur dans une situation difficile parce qu’il ne peut pas dire que ça ne marche pas. Après ça, c’est une appréciation : « Est-ce que j’aime la musique ou pas ? » Et là on s’aperçoit que le réalisateur, quand le monteur va dire : « Oh non, non, ce n’est quand même pas comme ce qu’on avait », il répond : « Oui mais tu vois là, cet instrument, ça marche, j’aime ça. » Là, le monteur est mis de côté et n’est plus forcément dans l’approbation des musiques. Puis je peux continuer ma stratégie et ma collaboration avec le réalisateur, comme elle aurait dû être depuis le début.
Ça se passe souvent dans un climat de confiance, avec les réalisateurs ?
Oui. En fait, c’est toujours pareil, nous, les compositeurs, on a notre cheminement, notre voyage personnel, qui fait en sorte qu’on arrive avec un bagage d’expérience, de confiance en soi. Et c’est pareil dans le milieu des réalisateurs. Pour Nostalgia, quand Mark (Pellington) m’a choisi, c’était vraiment pour ma musique, et ce film est bien particulier car on est tous les deux touchés très personnellement par la mort et les morts subites de proches. Mais lorsque je travaille avec des réalisateurs comme ça, c’est un peu comme les belles années du cinéma, c’est-à-dire que ce sont des gens qui nous disent : « Voilà, c’est mon film, je te choisis parce que j’adore ce que tu fais. » Et ils sont extrêmement excités de nous dire : « C’est ton film maintenant. Amène ta vision, amène ton art à notre film. » Comme un échange entre artistes si vous voulez, plutôt que certains réalisateurs qui ne vont pas avoir autant confiance en eux ou qui vont tomber dans le micro-management ou qui vont travailler sur une musique temporaire, en se disant « Il n’y a que ça qui peut marcher pour mon film. » Ils vont donc avoir un compositeur pour essayer de copier ce qu’eux pensent que la musique devrait être. Ça va aussi avec l’expérience et la confiance en soi des réalisateurs.
Peut-être que ceux qui choisissent l’émotion bénéficient d’une sensibilité particulière ?
Oui, je pense qu’ils ont une sensibilité particulière et qu’ils ont écrit le film d’une certaine manière. Il y a toujours des scènes pour faire respirer, où la musique devient le troisième personnage. Nostalgia a vraiment été créé dès le départ comme ça, avec peu de musique. Mais quand elle est là, elle a toute sa valeur. C’est une approche intellectuelle, c’est une approche différente au niveau de l’art. Quand vous positionnez comme ça votre film, ça doit être de l’art visuellement, où il y a une certaine beauté. Il ne s’agit pas juste de faire un film et puis de le vendre, mais c’est de dire : « J’ai fait quelque chose de très personnel. » Cela fait qu’on se retrouve à travailler avec des artistes absolument passionnants parce que chacun est là pour apporter quelque chose.
Tu fais beaucoup de films historiques. C’est conscient ? C’est le hasard des rencontres ?
Non, en fait si on regarde les drames, même dans le cinéma français ou le cinéma d’auteur, les drames ont tendance à rester très minimalistes au niveau des musiques. Quand on tombe par contre dans des drames historiques, la musique doit vous ramener à une certaine période, ce n’est pas juste les costumes ou le design, on compte sur la musique aussi pour nous amener dans cette période-là. Et je pense qu’il y a une association où quand on fait des films historiques on pense aux belles musiques. C’est vrai que les gens pensent à Autant en Emporte le Vent, des films historiques où il y avait de la place pour la musique, et je pense que c’est ce qui fait en sorte que les choix se font comme ça, et qu’effectivement on m’appelle pour des films historiques… Je n’y avais pas pensé jusqu’à maintenant.
Dans ta musique, il y a un peu de toutes ces différentes racines, un côté très européen et, peut-être plutôt dans l’électronique, un côté proche de ce que font les Américains…
Oui, différents mondes. Dans l’écriture aussi. C’est marrant, le projet que je viens de terminer, la série Clash Of Futures: 1918-1939 (Les rêves brisés de l’entre deux-guerres), diffusée en France sur Arte – j’ai travaillé sur cette série pendant deux ans – c’était un de mes seuls projets en Europe, le reste c’était des films américains. À un moment donné, on a eu une période de coupure de six mois pendant lesquels j’ai travaillé, parce qu’ils étaient en plein tournage et en train de faire le montage. Quand je suis revenu, ça m’a pris quelques semaines avant de pouvoir replonger dans l’écriture à l’européenne. Il y a une pièce qui est pour le réalisateur une pièce américaine : Freedom, qui est beaucoup plus orchestrale, enlevée, à l’américaine, mais à chaque fois il me disait : « Laurent, Laurent, quitte ta casquette américaine. Reviens avec ta casquette française ! » (rires) Dans l’écriture aussi, c’est jouer avec ces deux mondes-là.
Peux-tu nous expliquer ce que tu avais en tête en choisissant de mettre en avant la trompette ?
Après avoir fait la première série, 14: Diaries Of The Great War (14 : Des Armes et des Mots), qui était passée il y a quatre ans pour le centenaire de la Première Guerre mondiale – toujours avec la même équipe, toujours pour Arte et la BBC – la signature musicale que j’avais donnée était plus basée sur l’industrialisation. On couvrait quatre années. Quand la nouvelle série a été mise en route, je me suis assis avec le réalisateur Jan Peter, et il m’a dit : « Écoute, je veux encore avoir ta signature pour cette série-là, mais le problème c’est qu’on ne couvre plus quatre ans, on est sur 21 ans d’Histoire. » Comment est-on capable d’accrocher une signature musicale sur 21 ans d’Histoire ? Qui en plus représentent de gros changements, depuis le jazz jusqu’à la montée du nazisme, du fascisme, où on avait les chœurs, c’était plus le côté armée, le côté puissant. Et Jan m’a dit : « Qu’est-ce que tu penses d’un instrument à vent, d’un cuivre, comme la trompette ? » Je lui ai dit : « La trompette pourrait être un bon choix parce qu’on couvre les débuts du jazz tel qu’il est apparu à ce moment-là à Berlin et en France. Et puis la trompette peut devenir de plus en plus solennelle, avec son utilisation dans les mouvements de marches militaires, dans ce côté-là elle peut nous accompagner jusqu’à la limite de 1939. » On a décidé comme ça d’utiliser la trompette et je lui ai donc donné des saveurs, des sonorités un petit peu particulières, en utilisant la Harmon cup pour donner le côté un peu jazzy, pour donner un peu de mélancolie sur l’une des pièces, comme du Miles Davis. Pour aller après ça vers la trompette classique. Parfois les deux sont ensemble, pour montrer la juxtaposition et la transformation dans la société.
Le support visuel est un docudrame, un mélange d’écriture de fiction pour des personnages réels ?
Ce sont des personnages réels, qui ont existé. En fait, il y a treize ou quatorze personnages qui vont de Rudolf Höss à Hô Chi Minh, Pola Negri… Et ils ont pris des acteurs qui leur ressemblent physiquement, donc on vit leur histoire depuis 1919. On voit comment Rudolf Höss va se radicaliser et devenir l’un des nazis les plus terribles. On voit Pola Negri qui rêve d’aller vivre aux États-Unis et qui y passe au travers du cinéma muet… On a ces images et des images d’archives qui viennent s’impliquer tranquillement au travers de cette fiction, pour nous recaler en permanence sur ce qui se passait, avec de vraies images.
Le réalisateur avait donné des instructions précises sur le mélange de genres ?
Non, en fait Jan m’a dit depuis le début : « Je te donne carte blanche. La seule chose que je te demande de faire c’est que je voudrais connaître ce que serait le monde de Laurent Eyquem, la musique de Laurent Eyquem, si tu traversais ces années-là. » Après ça, les seules petites restrictions qu’il pouvait avoir, c’était de me dire : « Ici, j’ai besoin d’une mini-suite » ou « J’ai besoin d’avoir un mouvement comme quand on est dans des trains ». La pièce Spy In The Train par exemple rappelle un peu les musiques de Bernard Herrmann, des films de ces années-là. Il y a certaines musiques sur lesquelles on va avoir des mouvements perpétuels également, pour rappeler que les choses avancent. Sa demande particulière sur toutes les pièces musicales, c’était qu’il fallait toujours que, dans mon écriture, je maintienne une incertitude. Il me disait que même si les choses étaient très positives – car les gens croyaient en certaines choses qui se sont avérées être vraiment de mauvais mouvements, ils avaient quand même une certaine positivité – par contre, il y avait un doute qui était toujours là. Est-ce que les choses ne vont pas changer pour le pire à n’importe quel moment ? Il m’a dit : « Même dans les choses les plus positives, je veux sentir une certaine mélancolie et une incertitude. » Peut-être par des dissonances, donc parfois la trompette est à la limite d’une certaine dissonance. D’autres fois, comme quand j’ai écrit la pièce de valse pour Pola Negri qui quitte Berlin, la valse est d’habitude quelque chose de gai, qui nous amène quelque part, mais je l’ai écrite avec des changements d’accords qui font qu’il y a une mélancolie qui est là dans la mélodie. Il y a une certaine joie mais avec une mélancolie, elle quitte Berlin et ne sait pas exactement ce qu’elle va rencontrer aux États-Unis. Il y a l’incertitude : est-ce que sa carrière va fonctionner ? Elle vient de se faire voler les bijoux de la royauté qu’elle venait d’acheter, il y a plein de choses qui se passent dans sa vie… Donc, c’est de jouer comme ça sur des intentions puis sur un climat politique.
Ce mouvement sous-jacent permanent est aussi une manière de suggérer le passage du temps ?
Oui, et puis de signaler qu’il y a finalement une inévitabilité. Le temps va passer, se répéter, mais ce qui s’en vient est inévitable, quels que soient les mouvements sur lesquels les gens vont concentrer leur action sociale ou politique, il y a une inévitabilité qui arrive. C’est pour ça qu’il y a toujours le mouvement perpétuel, quand il va être au piano par exemple, lui ne va pas bouger, la mélodie va bouger autour, mais le mouvement perpétuel c’est comme la fondation de la société qui avance toujours. On ne peut pas stopper le temps. On ne peut pas stopper ce qui va arriver.
Il y avait beaucoup de musique à composer au total ?
On a fait huit épisodes. C’est peut-être l’un des plus gros documentaires européens, avec un énorme budget de coproduction entre le Luxembourg, la France et l’Allemagne. Il reste que d’habitude, les budgets pour la musique sont très restreints, mais on a quand même eu un beau budget qui nous a permis d’enregistrer 120 minutes avec l’orchestre symphonique à Berlin. Ça nous a permis de pouvoir couvrir chaque épisode, où il va y avoir le même thème, la même musique qui revient quand on va décrire les personnages. Ça c’est un travail avec Jan, où on a divisé le travail en 50 % des musiques écrites en mini-suites, basées donc juste sur des émotions, et 50 % basés sur de la composition à l’image, dès que c’était tourné, pour des scènes spécifiques où on avait vraiment besoin d’une atmosphère particulière.
Il y a des techniques utilisées pour faire que ces mini-suites puissent être découpées à loisir ?
Ce que j’ai essayé de faire systématiquement, c’est un changement de rythme au milieu, un changement soit tonal soit dans l’atmosphère, tout en restant dans la même mélodie, pour pouvoir donner la possibilité d’une utilisation plus positive ou plus négative, où il y a un peu plus de doute. J’ai essayé de créer ces mini-suites pour qu’elles soient le plus facilement exploitables. J’avais reçu tous les scripts à l’avance, avant le tournage, donc j’avais une idée de ce qu’on allait faire. Et puis c’est une deuxième collaboration donc il y a aussi une manière de travailler, de se faire confiance, qui est là et qui facilite les choses.
Donc, 120 minutes d’orchestral mais aussi de l’électronique, puis les deux mêlés par moments ?
Oui, on a mêlé de l’électronique, mais beaucoup moins que dans la série 14, puisque dans celle-ci, la Première Guerre mondiale c’était l’industrialisation, autant de la machine de guerre que de la société, donc l’électronique était très présente. Là, c’était plus pour maintenir le mouvement et garder un aspect d’incertitude, chaotique.
Est-ce que ce que tu visualises est parfois contrarié par les moyens alloués à la musique ?
Oui. Et d’ailleurs, le défi de la série a été énorme là-dessus. J’aurais dû travailler avec l’orchestre symphonique de Babelsberg. En fait, tous les orchestres avec lesquels on enregistre, on va les adapter pour les séances d’enregistrement, les sessions comme on les appelle, en fonction de notre écriture, de ce qu’on a besoin pour les films. Ce ne sont pas les orchestres symphoniques habituels de 55 musiciens. Parfois, j’enregistre avec 85-90 musiciens, parce qu’on va avoir énormément de cordes, beaucoup plus de contrebasses, de violoncelles… J’avais commencé à écrire comme ça presque 50 % de la série, et on s’est aperçu que l’orchestre n’est pas de ceux dont on peut changer l’effectif. Il y a un certain nombre de musiciens. Il n’y avait que 26 instruments à cordes. Et les journées où j’allais avoir besoin de 55 musiciens, je ne pouvais pas avoir 55 cordes, j’en avais juste 26. Il a donc fallu tout réorchestrer, faire deux passages, des divisi, faire doubler. C’est beaucoup de travail de préparation, avec les copistes et l’orchestrateur. S’assurer qu’il y ait deux passages qui soient écrits, qu’on ait des notes pour faire des doublages. Et puis, pour mon ingénieur qui travaille avec moi sur tous les films, qui voyage partout, il faut que les sessions soient prévues comme ça, pour qu’on sache tout ce qu’on doit faire, qu’on doit doubler les cordes là, doubler cette mélodie, pour arriver à compenser. À chaque fois, il y a des adaptations. On doit s’adapter au niveau des musiciens, ce qu’ils sont capables de faire.
Quels sont tes projets dans un proche avenir ?
Là, j’ai travaillé sur un film de manière indirecte. C’est un film qui, par les crédits d’impôts, a dû passer par un certain pays. C’est un film de John Travolta, qui m’a demandé à la fin de superviser la musique du film et d’utiliser pas mal de mes musiques en librairie pour les ajuster au film. C’est ce que j’ai fait ces derniers mois. Le film sort en novembre et s’intitule Speed Kills. C’est l’histoire vraie du créateur des bateaux speedboat qui étaient utilisés par les cartels de drogue, et puis Georges Bush a donné le contrat à cette personne-là de faire des bateaux pour le gouvernement américain. Mais comme il avait eu l’argent de la mafia, elle l’a obligé à faire en sorte que les cartels récupèrent tout l’argent du gouvernement américain qui était donné pour les bateaux. Puis, quand il a voulu s’en sortir, il a été assassiné à Miami. C’est cette histoire-là. Je travaillais avec les mêmes producteurs que les films Tokarev et USS Indianapolis, et puis directement avec Travolta.
Ce n’est pas un peu frustrant de devoir reprendre des morceaux existants ?
Je n’ai pas seulement repris des morceaux existants. En fait, il y a eu pas mal de changements dans la vision de la musique, entre ce qui avait été commencé et ce que voulait John Travolta. Par exemple, quand John Travolta m’a appelé, il m’a dit : « Écoute Laurent, il y a la scène de bateau où on me voit avec toutes les images d’archives des années 1960 à Monaco, toutes les courses. Tu te rappelles le film de Claude Lelouch, Un Homme et une Femme ? Tu te rappelles le style de musique quand Jean-Louis Trintignant fait la course de voitures ? » Je lui dit : « Oui, oui, c’est un peu à la Bernard Herrmann. » « Oui, j’aime ça. Est-ce que tu penses que t’as une musique qui pourrait fonctionner ? » Alors j’ai mis une de mes musiques. Ils m’ont pris beaucoup de musiques en licence pour le film, puis j’ai travaillé directement avec John Travolta pour en réadapter certaines, parfois prendre un thème et le réadapter, et on a fait certains réenregistrements.
Travailler avec Travolta, ça doit être quelque chose…
Ce que je ne savais même pas, c’est que dans ses contrats, il y a une obligation qu’il approuve la musique de ses films. C’est un fanatique de musique, il a une connaissance incroyable. Quand on discutait, il en savait même plus que certains réalisateurs avec qui j’ai travaillé. Il avait des connaissances musicales sur des choses, la musique brésilienne… Il me dit : « Okay, ici, dans le bateau, est-ce que tu peux me faire quelque chose dans le style de Stan Getz, tu sais, mais « meets Copacabana ? » » Non, vraiment, c’est quelque chose de passionnant pour lui, la musique est super importante. Il me l’a répété plusieurs fois. C’est un honneur d’avoir travaillé avec lui.
Tu nous avais parlé il y a deux ans d’un projet avec Roland Joffé. Ça ne s’est pas fait ?
En fait j’ai perdu ce projet-là à la dernière minute tout simplement à cause de crédits d’impôts. C’était le film qu’il a sorti sur Desmond Tutu (The Forgiven, 2017), sur lequel on avait commencé à travailler depuis deux ans et à la dernière minute ils ont perdu un investissement d’Angleterre, donc ils ont été obligés de passer à 100 % de crédits d’impôts en Afrique du Sud, comme ça se passe de temps en temps, et donc j’ai perdu le projet. Mais Roland en a un autre, une mini-série sur Notre-Dame de Paris. On a des projets ensemble, à propos desquels on se parle et on prépare des choses…
Entretien réalisé le 17 octobre 2018 par Olivier Desbrosses et Stéphanie Personne
Transcription : Milio Latimier
Illustrations : © DR
Remerciements à Séverine Abhervé, Marie Sabbah, toute l’équipe du Film Fest Gent et tout particulièrement à Laurent Eyquem pour sa disponibilité et sa gentillesse