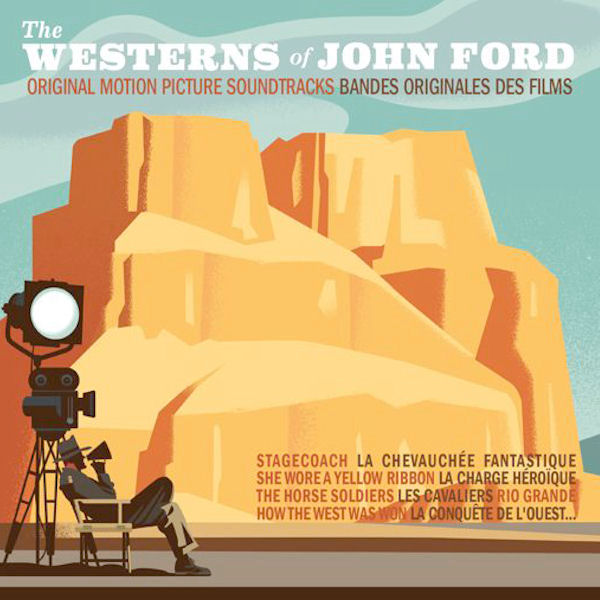KING KONG (1933)
KING KONG (1933)
KING KONG
Compositeur : Max Steiner
Durée : 73:34|20 pistes • 47:58|12 pistes • 72:19|22 pistes
Éditeurs : Rhino • Southern Cross • Marco Polo / Naxos
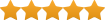
« Did you ever heard of… Kong ? » Cette question faussement sibylline, posée par Carl Denham au spectateur de 1933 autant qu’à ses comparses du film, annonçait clairement la couleur. Personne n’oublierait le spectacle hors norme concocté par les réalisateurs Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, champions de l’aventure exotique, ainsi que le spécialiste des effets spéciaux Willis O’Brien, et l’un des musiciens les plus doués et prolifiques de l’époque : Max Steiner, viennois d’origine, filleul de Richard Strauss, élève de Brahms et de Mahler – voilà pour sa lignée musicale. Plus de quinze films en 1932, dont The Most Dangerous Game (Les Chasses du Comte Zaroff), ébauche stylistique de Kong dont il partage certains thèmes et décors, et encore douze en 1933, l’année du chef-d’œuvre qui lancera pleinement sa carrière jusqu’à ce qu’un autre classique, Gone With The Wind (Autant en Emporte le Vent), le rende éternel.
King Kong, film exploit surgissant des tréfonds de notre psyché, méritait le meilleur de Steiner. Avec l’aide de son orchestrateur Bernard Kaun, il ne va pas composer une simple illustration musicale, mais une cathédrale de fantasmes et de fureur, érigée sur une base de seulement trois notes, solide comme le granit. Sa musique, c’est Skull Island. Une fois passés l’ouverture et le générique, Steiner se tait durant vingt minutes, le temps pour nos marins d’aborder le brouillard où se terrent l’île et ses mystères. À partir de là, il ne nous lâchera plus jusqu’à un épilogue célébrant la tragédie du monstre, de « l’autre » incompris, qui fait école encore aujourd’hui. Du papier-peint musical ? Oui, Steiner en fut l’incarnation la plus fameuse. Mais, dans le cas de Kong, ô combien nécessaire : en ces débuts du parlant où le mixage optique était rudimentaire, difficile d’offrir à ce monde perdu toute sa richesse par le biais des bruitages, même s’ils furent particulièrement soignés. Ce fut donc à la musique – malheureusement elle aussi amoindrie par la technique – de hausser le ton, d’enrichir les visuels somptueux en combinant rythme, exotisme, émotions et danger dans un ensemble cohérent.
D’emblée, le motif principal de trois notes descendantes (auquel les futurs « remakeurs » rendront hommage) sonne tragique. Son ascendance est l’opéra. Présenté par les trombones dès le générique, c’est un thème du destin autant que du monstre, malléable, évoluant du mystère à la fureur, à la tendresse ou au drame, glissant d’une famille instrumentale à l’autre en fonction des besoins. Un motif lié à Skull Island, un pour Ann Darrow (d’un romantique plus léger) et quelques autres viennent enrichir ce canevas en fonction des besoins. De larges pans de la composition sont d’abord descriptifs, suivant l’action pas à pas, allant jusqu’au mickey mousing qui ailleurs pourrait sembler daté, mais est ici une force. D’autres moments musicaux se déploient sans complexe au-dessus de l’image, imposant leurs propres lignes. À grand renfort de cuivres et de percussions, mais aussi d’une mobilité permanente des bois, les grandes scènes s’enchainent avec la régularité des dinosaures du film, en particulier la danse primitive et la cérémonie sacrificielle, l’entrée de la bête, la scène du déshabillage de la belle (où Steiner ne néglige pas l’humour pour faire passer la pilule), la grande séquence new-yorkaise et bien sûr le climax – clôturant, coup de génie, une attaque de biplans uniquement menée par le fracas des moteurs et des mitrailleuses. Certains moments de rage (comme la destruction du village) atteignent des sommets de violence brute, au niveau de la sauvagerie primale incarnée par Kong. Au premier abord, écouté sans l’image et sur la durée, on pourrait trouver la partition indigeste, étouffante. Son caractère constamment tendu et mouvant se veut plus descriptif que mélodieux. Mais il serait plus que dommage de s’arrêter à ça, quitte à ne pas grimper la montagne (du crâne, bien sûr) d’un seul bloc. D’où l’importance de bien choisir – s’il faut choisir – la version que l’on souhaite écouter : outre les extraits dirigés par Charles Gerhardt pour la série des Classic Film Scores, trois éditions majeures de King Kong se côtoient dans les bacs.
D’abord, rendons à la RKO ce qui lui appartient avec le CD de l’enregistrement original, compilé par Ray Faiola pour le label Rhino en 1999. Précisément, 9 pistes totalisant 24 minutes de musique « pure » issues de 78 tours y sont présentées, plus une trentaine de minutes extraites du film avec bruitages et dialogues. Leur qualité sonore reste éloignée des standards actuels, mais leur valeur est incontestable : ce sont les seuls témoins de l’orchestre et de la direction de Max Steiner. Il faut toutefois nuancer. Contrairement à certains enregistrements originaux considérés comme irremplaçables, celui-ci accumule les imperfections. L’ensemble orchestral trop réduit – un maximum de 46 musiciens – obligea certains d’entre eux à changer plusieurs fois d’instrument durant une prise, quitte à passer de l’alto au célesta. Steiner n’écrivit d’ailleurs pas en fonction de cette réalité. Ce fut à son orchestrateur de simplifier. Il sacrifia nombre de combinaisons instrumentales pour s’adapter au budget, ainsi qu’aux limites des matériels d’enregistrement. Les cordes, en particulier, manquent d’épaisseur. À l’écoute de cette édition, l’envie d’un enregistrement à même de traduire les dimensions de l’œuvre se fait donc cruellement sentir.
Glissons vite sur le premier redux, que l’on pourrait aussi qualifier de naufrage, le LP United Artists dirigé en 1975 par LeRoy Holmes. Exécuté (c’est le cas de le dire) en 10 titres, son principal mérite a été d’être le premier album stéréo dédié au gorille géant. Pas pour longtemps. Dès l’année suivante, profitant de l’élan publicitaire du remake de John Guillermin, John Lasher et Entr’acte nous gratifient d’un superbe album de 46 mn dirigé par Fred Steiner à la tête du National Philarmonic Orchestra, enregistré avec classe par Bob Auger à St. Giles Church (disponible en LP puis en CD sur label Southern Cross). Pour beaucoup, ce fut une révélation. Toujours fidèle à l’esprit mais corrigeant parfois la lettre, l’indispensable Christopher Palmer réarrange le matériel de Steiner et Kaun en 12 plages, dont un Kong Escapes / Aeroplanes / Finale de haute volée, certainement la plus belle version du final qu’il m’ait été donné d’entendre. L’orchestre est parfait, clair, capté dans une perspective naturelle mais sans réverbération exagérée. Affranchi des images, Fred Steiner (aucun lien familial avec Max Steiner) élargit le tempo quand nécessaire (la chute de Kong !), redonnant à la musique une respiration qui alimente sa grandeur, sans en gommer la tension. Seul point critiquable, l’arrangement de la Jungle Dance qui minore étrangement les syncopes rythmiques de l’original. L’un dans l’autre, cet album a d’immenses mérites. Si on est prêt à se contenter de 46 minutes, c’est un excellent choix, et si on préfère les intégrales, il reste un complément plus que bienvenu.
Enfin, dans un ultime redux en 1997, William J. Stromberg nous donne enfin l’œuvre intégrale sur label Marco Polo (repris par Naxos), interprétée par le Moscow Symphony Orchestra. Plus fidèle à l’original que ne l’est (par instants) Palmer, John W. Morgan donne leur forme « idéale » aux intentions de Steiner. Loin de reproduire servilement la musique enregistrée en 1933, il se réfère au conducteur et le réorchestre pour son ensemble moscovite, sans tricherie sur l’effectif, rétablissant les doublures harmoniques et rééquilibrant les masses instrumentales, bref, corrigeant les compromis opérés par Kaun. Mais il conserve néanmoins les choix essentiels de ce dernier, afin de recréer au mieux l’équilibre entre stridences et rondeurs – et les timbres rauques, parfois – que l’on associe à l’original. Dans cette optique, l’orchestre est capté de manière plus compacte, il joue de manière moins brillante, parfois, que le Philarmonique du disque de John Lasher, mais se montre fidèle aux sensations procurées par l’original – ce à quoi la reprise des tempos d’origine, souvent rapides voire heurtés, participe pleinement. En 22 plages et 72 minutes comprenant des mesures inédites, c’est bien la bande son du film qu’on a le sentiment d’entendre, dans de bien meilleures conditions. En résumé, on pourrait rêver d’un écrin sonore encore plus chatoyant (ce que la même équipe proposera plus tard dans la série des Tribute Film Classics), mais Stromberg et Morgan ne déméritent en rien : leur offrande au dieu Kong est à la hauteur des cauchemars et de l’émerveillement que l’île du crâne n’a cessé de nous procurer, depuis plus de quatre-vingt-cinq ans.