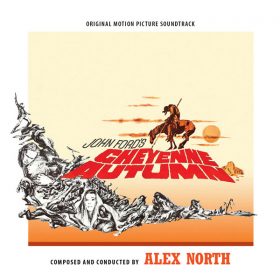Une étude d’ensemble sur les relations entre musique contemporaine et musique de film est difficilement envisageable, étant donné l’énormité du corpus de musiques écrites pour l’écran. Tout au plus pourrait-on tenter une approche par pays, par genre cinématographique, dans l’œuvre d’un cinéaste ou dans un mouvement, comme la Nouvelle Vague. On proposera donc modestement quelques aperçus sur la période charnière des années 30/40, centrés sur les cinémas européen et américain. Enjambant la chronologie à grand pas, on esquissera rapidement les grandes lignes et les thèmes structurants, en mettant en avant les grands noms ayant apporté une contribution significative à la composition pour l’image.
Précision importante : on abordera uniquement dans cet article les musiques rattachées aux différentes écoles ou courants de ce qu’il est convenu d’appeler la musique « contemporaine », c’est à dire grosso modo ceux qui sont apparus et se sont développés dans la musique dite classique, c’est-à-dire « savante » et écrite au cours du XXème siècle, le XXIème semblant pour l’instant ne rien avoir apporté de décisif. On s’intéressera donc aux mouvements et écoles auxquels l’étiquette de « contemporaine » a été accolée, par opposition notamment à l’esthétique et au langage classique (au sens strict, celui de Mozart et Haydn) ou romantique. On ne parlera donc pas des musiques inspirées par le jazz, ou composées et jouées par des jazzmen, bien qu’il s’agisse là incontestablement, peut-être même plus que toute autre, d’une forme d’expression musicale propre au XXème siècle. Le sujet est passionnant mais réclamerait à lui seul une ou plusieurs études détaillées.
Les évolutions considérables du langage musical au cours du XXème siècle n’ont pas immédiatement été intégrées par les compositeurs de cinéma. Réalisateurs et plus encore producteurs sont en règle générale conservateurs en matière musicale, pour des raisons parfois simplement commerciales. Les anecdotes sur ce sujet sont nombreuses. Il en résulte une sorte de décalage chronologique, qui n’est toutefois pas si important qu’on pourrait le supposer. Rappelons en effet que dans les années vingt, en France, les compositeurs contemporains les plus en vue (Ravel, Schmitt, Ibert…) sont sollicités pour écrire des partitions pour un cinéma encore muet, la musique étant interprétée en direct par un petit orchestre. D’autres, plus jeunes, comme Arthur Honegger ou Maurice Jaubert feront même une importante carrière au cinéma, passant de la salle de concert à la salle de cinéma et vice-versa. Dans cette même approche de la musique de film, que l’on qualifiera de « rigoureuse », mentionnons encore Yves Baudrier, un temps associé à Messiaen et Jolivet dans le groupe Jeune France, et qui deviendra un excellent musicien de cinéma. Il sera l’un des premiers à théoriser cette pratique par son enseignement à l’IDHEC. Des trajectoires qui deviendront beaucoup plus rares par la suite.
La musique de film relève du paradigme de la musique « classique », comme une extension des formes de l’opéra et de la musique de scène ou de ballet. Des extraits d’œuvres préexistantes (pages orchestrales célèbres, extraits d’opéra ou d’opérettes) sont souvent utilisés au lieu d’une musique originale. Il ne semble pas y avoir à dans les esprits de barrière très définie entre musique contemporaine et musique de film. Florent Schmitt écrit pour Salammbô (1925) une somptueuse partition, dont l’orientalisme capiteux et l’ardeur belliqueuse sont en tous points comparables à ceux de La Tragédie de Salomé ou Antoine et Cléopâtre. Beaucoup de musiciens manifestent un intérêt pour le cinéma, sans la condescendance qui sera de mise plus tard. En 1932, Ravel compose des chansons pour le Don Quichotte de Pabst (non utilisées, elles deviendront les trois mélodies Don Quichotte à Dulcinée).

De façon plus inattendue, le cinéma est parfois une source d’inspiration pour des compositeurs majeurs n’ayant jamais écrit directement pour lui, comme Charles Koechlin avec sa Seven Stars’ symphony en hommage aux grandes stars du cinéma et Schoenberg avec sa Musique pour une Scène de Film. Dès 1930, Georges Auric entame quant à lui une collaboration cinématographique durable avec Cocteau, prolongement naturel de l’association de celui-ci avec le Groupe des Six. Auric allait composer abondamment pour le cinéma, mêlant les influences populaires, la musique de cabaret à des éléments symphoniques plus traditionnels, là encore dans l’esprit des Six. Faute d’une voix très individuelle, il apporte à son travail subtilité et légèreté de touche, comme pour le chef d’œuvre du fantastique que sont The Innocents (Les Innocents – 1961). À vrai dire, dans la France d’avant et d’après-guerre, il serait plus simple de chercher qui n’a pas travaillé à un moment ou un autre, succinctement parfois, pour le cinéma ou le court-métrage : on a évoqué le Groupe des Six et le groupe Jeune France, mentionnons encore Manuel Rosenthal, Serge Nigg, Maurice Le Roux, Marcel Landowski, et même Pierre Boulez. Des chefs de sensibilité moderne et de l’envergure de Roger Desormière ou Charles Münch ont par ailleurs dirigé pour le cinéma.
C’est également vrai, dans une moindre mesure, du cinéma anglais : Ralph Vaughan Williams, Benjamin Britten, William Walton ne dédaignent pas le cinéma, livrant des partitions d’un intérêt variable mais souvent plus faibles que leur production symphonique. Certains, comme Alan Rawsthorne, Benjamin Frankel ou Malcolm Arnold consacrent une part importante de leur activité au cinéma. Mais le plus grand compositeur anglais de cinéma est sans doute Brian Easdale. Ce musicien proche de Britten n’a jamais vraiment réussi à sortir de l’ombre de son grand aîné. Sa musique de film est pourtant d’une facture admirable, à la fois subtile et personnelle, d’une invention constante et d’une enivrante beauté mélodique.
Là comme ailleurs, la musique de film est le moyen de gagner sa vie comme compositeur. Walton raconte le changement radical que lui apporta son premier film en 1934. Pour dix jours de travail, il gagna plus que ce que lui rapportait en un an sa musique de concert. On connaît aussi l’anecdote du dîner entre Miklós Rózsa et Arthur Honegger, après un concert parisien qui leur rapporta quelques francs. Interrogé sur la manière dont il gagnait sa vie, le musicien suisse expliqua qu’il écrivait pour le cinéma. Cela n’empêche évidemment pas des collaborations d’une réelle valeur artistique ni des expérimentations parfois audacieuses. Ce même Honegger envisage ainsi d’utiliser une bande enregistrée jouée à l’envers pour le film Rapt (1934). Il arrive que certaines partitions donnent naissance à des œuvres de concert qui s’inscrivent durablement dans le répertoire. Pour ne citer que quelques exemples bien connus, la septième symphonie de Vaughan Williams, Sinfonia Antartica, est issue de sa partition pour le film d’aventure polaire Scott Of The Antarctic (L’Épopée du Capitaine Scott – 1948). Prokofiev, toujours pragmatique, tira une cantate de celle du film Alexandre Nevski d’Eisenstein. Quant à Korngold, il tirera de ses musiques de films (au nombre de seize seulement) le matériau de plusieurs de ses œuvres ultérieures (sa très belle Symphonie en Fa Dièse ou son Concerto pour Violon notamment). Beaucoup de musiciens adoptent immédiatement la pratique, courante pour le ballet ou l’opéra, de tirer des suites symphoniques de leurs partitions, destinées au concert. Ainsi Waxman pour Rebecca (1940) ou Rozsa pour The Jungle Book (Le Livre de la Jungle – 1942). Celles de Walton, issues des adaptations shakespeariennes de Laurence Olivier, sont bien installées dans les programmes. Dans le même ordre d’idée, mais en plus commercial, mentionnons le jadis fameux Concerto de Varsovie de Richard Addinsel, romance pianistique mêlant Grieg et Rachmaninov, tirée du film anglais Dangerous Moonlight (1941). Encouragé par ce succès, l’éditeur américain de la musique de Miklós Rózsa pour Spellbound (La Maison du Docteur Edwardes – 1945) d’Hitchcock décida de diffuser un Spellbound Concerto, obligeant le compositeur à arranger rétrospectivement sa musique pour lui donner l’allure d’un bref concerto.

Vers la même période, en Union soviétique, Prokofiev, figure de proue de la musique moderne en URSS, mais aussi son remuant cadet Chostakovitch travaillent ponctuellement pour le cinéma, tous les deux dans un style très similaire à celui de leur musique de concert ou de ballet qui, sans être révolutionnaire, appartenait encore à cette époque à l’aile moderne de la musique. La suite du Lieutenant Kijé (1934) deviendra même une des œuvres les plus populaires de Prokofiev. Le travail cinématographique prend un caractère différent dans ce pays, moins spontané, car il est un des aspects de l’activité « officielle » des musiciens et des artistes en général, qui doivent répondre à diverses commandes du régime.
Aux Etats-Unis, les choses se passent différemment, et prennent rapidement, dans les grands studios, un tour plus organisé, pour ne pas dire industriel. La musique de concert américaine est naissante et les quelques noms qui comment à s’affirmer dans des styles bien différents : Ives, Copland, Gershwin, Varese (celui-ci français de naissance) ne sont pas dans la même situation que leurs collègues européens. Ils doivent d‘abord imposer l’existence d’une musique américaine « sérieuse », indépendante de celle du vieux continent. Le cinéma hollywoodien ne saurait être pour eux une voie envisageable. La figure centrale de la musique savante américaine, Aaron Copland, n’a apporté qu’une contribution limitée au Septième Art. Ses quelques partitions, toutes écrites dans les années 40 (à l’exception d’une seule) sont d’un langage assez traditionnel. Our Town (Une Petite Ville sans Histoire – 1940), The Red Pony (Le Poney Rouge – 1949), Of Mice And Men (Des Souris et des Hommes – 1939) s’inscrivent dans la veine americana, tantôt pétulante tantôt hymnique, des ballets Rodeo, Billy The Kid et Appalachian Spring.
A la faveur du contexte politique des années 30 (montée du nazisme, totalitarisme soviétique), c’est à l’Europe que le Hollywood de l’époque emprunte une bonne part de son personnel musical. Compositeurs, arrangeurs, chefs d’orchestre, instrumentistes. Musiciens de toutes origines, mais souvent allemands, autrichiens, slaves et/ou d’origine juive rejoignent en nombre les départements musicaux déjà très structurés, hiérarchisés, compartimentés de la Warner ou de la Twentieth Century Fox. Certains avaient une carrière de compositeur plus ou moins active, mais devront s’adapter à un contexte et une culture professionnelle très différente, où la musique est, pour reprendre l’expression de l’époque, une gebrauchsmusik, une musique utilitaire prenant sa place dans un contexte de production plus large. La différence majeure par rapport au travail de composition classique est la brièveté des délais et leur caractère impératif. Steiner n’aura ainsi que deux semaines pour écrire la musique d’un classique comme The Most Dangerous Game (Les Chasses du Comte Zaroff – 1932), fait qui n’a rien d’exceptionnel. Ensuite, et c’est lié, le recours obligé à un ou plusieurs orchestrateurs pour respecter ces délais. Enfin, la présence d’un directeur musical, plus ou moins bon musicien, qui est souvent celui qui dirigera la musique. Ajoutons la liberté – ou l’arbitraire – du réalisateur et du producteur dans l’utilisation, ou la non-utilisation, de la musique. Autant de contraintes qui expliquent ce qui peut être vécu par certains comme une aliénation de leur liberté artistique. Les déconvenues sont par ailleurs fréquentes chez les compositeurs abordant le genre pour la première fois. On connaît les démêlées de Stravinsky avec la Fox et ses projets avortés pour Jane Eyre et The Song Of Bernadette (Le Chant de Bernadette) en 1943. Quelques années plus tard, Villa-Lobos, sollicité par la MGM, verra sa partition pour Green Mansions (Vertes Demeures – 1959) de Mel Ferrer, écrite très en amont de la version montée du film, en partie rejetée, en partie réarrangée par un autre musicien. Frustré, il en tirera une nouvelle œuvre à part entière, Forest Of The Amazon.

Trois compositeurs européens de culture germanique vont largement contribuer à donner à la musique de film américaine ses grandes caractéristiques : Max Steiner, Franz Waxman et Erich Wolfgang Korngold. Leur langage est essentiellement issu de Wagner, Richard Strauss et Puccini, avec des traces de Tchaïkovski et Rachmaninov. Sous leur plume, la musique de film américaine change progressivement de style. Broadway, le cabaret, la chanson populaire ne sont plus les seules références. Il s’agit de renvoyer à l’esthétique plus noble des grandes pages romantiques et en particulier de l’opéra, l’œuvre d’art « totale » alliant jeu dramatique, décors, costumes et musique. Ce même Korngold venait d’ailleurs de créer, quelques années auparavant, les dernières et peut-être les plus flamboyantes illustrations du genre avec ses deux derniers opéras, La Ville Morte et Le Miracle d’Héliane.
Arrivé à Hollywood dès 1930, l’autrichien Max Steiner est l’archétype du compositeur de musique viennoise. Plus qu’aucun autre sans doute, il a contribué à imposer au cinéma des débuts du parlant une forme de standard symphonique généreusement post-romantique, mais assez éloigné des préoccupations de l’avant-garde de son époque. Sa musique pour King Kong (1933), malgré le côté vieillot de certains effets trop imitatifs, a été l’une des premières vraies partitions entièrement symphoniques, jouant sur les frottements harmoniques, la dynamique des masses orchestrales, le caractère obsessif du rythme, au point qu’on a parfois comparé cette partition à un Sacre du Printemps pour orchestre de Broadway. La matière préhistorique semble en tout cas avoir éveillé chez Steiner une sensibilité barbare inattendue. Plus étonnant, Steiner utilise dans certaines de ses westerns des procédés de collage de thèmes, de chansons populaires ou d’airs patriotiques, dont la superposition évoque parfois curieusement les travaux très expérimentaux de Charles Ives. Citons certains passages de They Died With Their Boots On (La Charge Fantastique – 1941) ou Gone With The Wind (Autant en Emporte le Vent – 1939). Dans ce film grand public, il insère une reprise déformée et très discordante d’un air anglais pour la scène ou l’enfant de Rhett et Scarlett fait un cauchemar. L’approche empirique et intuitive d’un musicien plutôt conservateur le rapproche ainsi, contre toute attente, de l’esthétique d’un des grands novateurs de la musique du XXème siècle. La plupart du temps, la musique de Steiner, en matière d’exotisme notamment, se contente de jouer adroitement des conventions, un peu comme le Strauss de Salomé, qui ne cherche pas à approfondir les caractéristiques d’un langage musical (oriental par exemple), mais à l’utiliser comme une indication dramatique pour l’auditeur/spectateur.

Autre viennois, arrivé à Hollywood quelques années après Steiner, Erich Wolfgang Korngold est un compositeur d’un style tout aussi romantique, mais plus raffiné et élaboré. Il est surtout le premier compositeur bénéficiant d’un réel prestige au concert et à l’opéra à avoir rejoint Hollywood. Lui-même a toujours considéré ses musiques de films comme des « opéras sans paroles », et dans ses partitions, comme dans celle de Steiner, la musique tend à être wall to wall, c’est à dire presque omniprésente, comme elle l’est dans un opéra. Sans être atonale, son ouverture pour The Sea Wolf (Le Vaisseau Fantôme – 1941), avec son orchestre cinglant et déchiré, ses percussions brutales, peut être considérée comme un écho un peu assagi des violences de l’expressionnisme musical européen. Pour The Sea Hawk (L’Aigle des Mers – 1940), il écrit une partition d’une élaboration faramineuse. Là encore, il aura fallu attendre le réenregistrement intégral, par l’équipe americano-moscovite de Naxos en 2006, pour en mesurer la richesse et la complexité, comparables à celles des œuvres de concert, sans atteindre toutefois à la beauté époustouflante de ses grands opéras.
Ouvrons ici une parenthèse pour insister sur ce point : les conditions parfois précaires et les limites techniques des enregistrements réalisés dans les années 30 et 40 ne permettent guère de se faire une idée, à la seule vision des films concernés, de la valeur musicale ou même simplement du contenu de ces partitions. Précisons que ces conditions précaires concernent notamment la taille des studios, les délais très courts accordés à l’enregistrement et le nombre d’instrumentistes (rarement ceux d’un orchestre symphonique au complet), mais jamais leur qualité qui, elle, a toujours été de très haut niveau. La musique de Steiner pour King Kong a été enregistrée avec 46 instrumentistes, certains jouant de plusieurs instruments et passant de l’un à l’autre selon les exigences de la partition. C’est dans les années 70 seulement, avec la luxueuse série des Classic Film Scores du tandem Charles Gerhardt – Georges Korngold chez RCA, que l’on a pu réellement mesurer la qualité et la modernité de certaines de ces pages. Ce travail d’exploration a été repris dans les années 90 avec la même ardeur et la même exigence par le duo William Stromberg – John Morgan, pour les labels Marco Polo et Naxos.

Dernier membre de ce grand trio austro-germanique, Franz Waxman se distingue par son association fréquente avec le genre du thriller et du film noir. Sa sensibilité est aussi plus sombre, moins ouvertement lyrique que celle de Steiner et Korngold. A Berlin, il s’est un temps intéressé aux récents développements de la technique dodécaphonique de Schoenberg. Ses compositions pour le concert, comme The Song Of Terezin, en portent la marque. Ce n’est pas un hasard si l’une de ses premières compositions américaines est celle de The Bride Of Frankenstein (La Fiancée de Frankenstein – 1935). Dans une esthétique globalement post-romantique, il introduit déjà quelques stridences et des sonorités électriques inhabituelles. Pour le mélodrame Mr. Skeffington (Femme Aimée est Toujours Jolie – 1944), il est peut-être le premier à composer une pièce atonale pour le cinéma (Forsaken). Ailleurs, pour Sorry, Wrong Number (Raccrochez, c’est une Erreur ! – 1948), il utilise une passacaille, une des formes les plus exigeantes de la musique savante, pour la scène finale. La pièce est d’une écriture assez « bergienne », bien que la structure en soit assez simple et plus lisible que ce qu’on peut entendre chez d’autres. Mieux, la fugue pour cordes de sa musique pour A Place In The Sun (Une Place au Soleil – 1951) présente une ressemblance frappante, mais a priori fortuite, avec celle de la onzième symphonie de Chostakovitch, composée plusieurs années après et dont il dirigera lui-même une des premières exécutions aux États-Unis.
Alfred Newman lui-même, le plus lyrique et le plus tendre des grands hollywoodiens, a créé d’étonnantes pages polytonales dans le Hunchback Of Notre Dame (Quasimodo – 1939) de Dieterle pour les scènes de la fête des fous. C’est l’occasion de rappeler son amitié, inattendue, avec Arnold Schoenberg, dont il permit le premier enregistrement intégral des quatuors et avec lequel il prit des cours de composition. Fred Steiner, le grand spécialiste de Newman, précise que celui-ci était très au fait des dernières techniques d’écriture, bien qu’il les ait rarement utilisées au cinéma.

Avec Korngold, Miklós Rózsa est l’un des très rares compositeurs hollywoodiens dont on puisse dire qu’il a eu une véritable carrière de compositeur de concert avant de se consacrer essentiellement à la musique de film. Sur le plan du langage, sa musique peut se résumer en quelques mots comme du Brahms mélangé de Bartók, mais la personnalité qui en émane est d’une force singulière. Débarqué à Los Angeles en 1940, avec l’équipe de production du Voleur de Bagdad (commencé à Londres mais interrompu en raison de la guerre), il apporte aux grands studios une magnifique maîtrise technique et une exigence formelle quasiment inconnue des musiciens hollywoodiens. Avec son style robuste et rythmique, tonal mais ne craignant pas la dissonance – dans la continuité de celui de Waxman – lui aussi devient rapidement un spécialiste du policier et du thriller. Il est intéressant de noter comment, dès ses premières partitions pour l’image, il adapte son style. Jusqu’alors sa musique est en effet fortement marquée par le folklore hongrois (rythme, mélodie, intervalles) et extrêmement contrapuntique. Désormais, un lyrisme plus schmalzy, d’une couleur un peu viennoise, marque souvent ses thèmes et le contrepoint se fait plus souple. Ce qui ne se traduit pas nécessairement par une baisse de qualité. Au contraire, l’écran a sans doute permis à Rózsa d’aborder des registres que la musique « sérieuse » ne lui aurait pas proposés, et de produire les chefs-d’œuvre luxuriants que sont The Thief Of Bagdad (Le Voleur de Bagdad – 1940), Quo Vadis (1951), Ivanhoe (1952), Lust For Life (La Vie Passionnée de Vincent van Gogh – 1956) ou Madame Bovary (1949). Et malgré les qualités éminentes de sa musique de concert, en particulier celles des années 30 (fraicheur, énergie, virtuosité), il manque un élément qui sans doute ne pouvait pas s’y trouver et que le cinéma, seul peut-être, pouvait lui apporter: le tragique. Pour les films noirs produits à la fin des années 40, ses musiques présentent déjà une nouvelle orientation : n’abandonnant ni la mélodie ni la tonalité, elles présentent cependant une dureté qui tranche sur l’approche plus moelleuse de la plupart de ses confrères. Ce durcissement était d’ailleurs en accord avec la volonté de réalisme, l’approche documentaire souhaitée par le producteur Mark Hellinger. On est frappé par la violence sèche, percussive, rageuse du Main Title de The Killers (Les Tueurs – 1946) de Robert Siodmak
Notons également que, composant pour des univers sombres, inquiétants, ces musiciens sont amenés presque naturellement à s’intéresser aux innovations en matière d’instruments électroniques : Waxman utilise le Novachord dans Rebecca, Rózsa le thérémine dans Spellbound et The Lost Weekend (Le Poison – 1945), la primeur revenant toutefois à Chostakovitch qui l’adopta dès 1931 pour le film Odna. En France, la carrière des ondes Martenot, cousines du thérémine mais disposant en plus d’un clavier, pourrait être un sujet d’étude en soi. Très vite adoptées par les compositeurs de cinéma, notamment Honegger dans sa musique pour L’Idée en 1932, elles furent aussi associées à la musique d’avant-garde de l’époque, Messiaen et Jolivet en faisant leur instrument fétiche. Pierre Boulez fut même « ondiste » pour des représentations théâtrales. L’instrument allait connaître dans les années 80 une seconde jeunesse inattendue grâce à Maurice Jarre et Elmer Bernstein, ce dernier les ayant découvertes par l’intermédiaire du compositeur anglais Richard Rodney Bennett.

A côté des grands noms évoqués ci-dessus, il faut aussi évoquer le rôle du méconnu Paul Dessau. Dans la dizaine d’année qu’il a passé à Hollywood, ce compositeur allemand adepte du dodécaphonisme fut une sorte d’homme de l’ombre de la musique de film. Travaillant souvent en collaboration avec d’autres compositeurs, en particulier sur des films fantastiques de série B, il contribua à irriguer d’une relative modernité ces partitions très fonctionnelles. C’est notamment le cas pour certains passages de la musique de House Of Frankenstein (La Maison de Frankenstein – 1944), coécrite avec Hans J. Salter (lui-même élève d’Alban Berg à Vienne). Partition complexe, difficile même, peu mélodique, dont le chromatisme tourmenté frôlant l’atonalité évoque une fois encore l’école de Vienne, sans doute pour compenser l’incroyable naïveté du film. Si l’on fait abstraction du caractère fragmenté de cette musique écrite pour l’image, on peut écouter dans la foulée les Symphonisches Hymnen de Karl A. Hartmann (1943) sans avoir le sentiment de changer radicalement d’univers.
C’est ici le moment d’évoquer l’existence souvent insoupçonnée d’une véritable « Schoenberg connection » à Hollywood dans les années 30/40, tant les relations sont nombreuses (et parfois inattendues) entre le grand révolutionnaire de la musique du XXème siècle, installé à Los Angeles depuis le milieu des années 30, et le milieu de la musique de film américaine. Pédagogues, chefs d’orchestres, compositeurs de la côte ouest sont nombreux à fréquenter le musicien allemand et à suivre son enseignement. Schoenberg attire aussi de jeunes compositeurs américains, dont la sensibilité progressiste les amènent à suivre son enseignement. Parmi eux, Hugo Friedhofer qui fut dès les années 40 de ceux qui introduisirent des éléments de modernité (mesurée) dans sa musique, notamment certains passages de The Lodger (Jack l’Éventreur – 1944) ou The Best Years Of Our Lives (Les Plus Belles Années de notre Vie – 1946), son chef d’œuvre.
Un autre de ses disciples fut David Raksin qui lui aussi nous entraîne parfois au bord de l’atonalité, dans certaines pages de Forever Amber (Ambre – 1947) ou Force Of Evil (L’Enfer de la Corruption – 1948). Pour The Man With A Cloak (L’Homme au Manteau Noir – 1951), il utilise peut-être pour la première fois au cinéma une série schoenbergienne. Indépendamment de toute question de modernité, on ne peut qu’admirer la maîtrise polyphonique et orchestrale qu’il déploie dans des pièces comme Whitefriars et The Great Fire Of London (deux des séquences les plus dramatiques de Forever Amber), qui font paraître assez sommaire la musique de certains compositeurs américains « classiques ».
On rappellera également la controverse sur la valeur de la musique de film qui opposa Raksin à Stravinsky dans une série d’articles de la revue The Musical Digest (1946-1948).
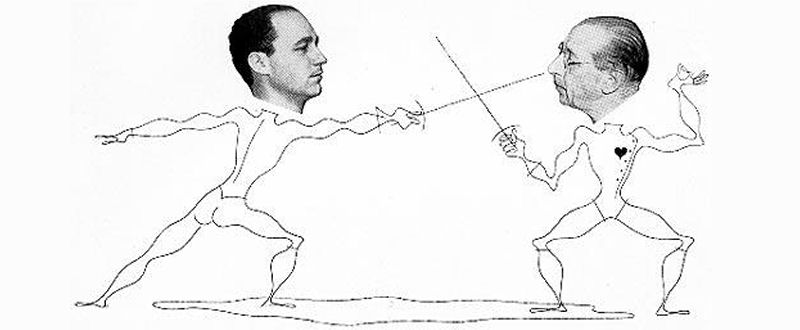
On aura remarqué que l’atonalité, avec le sentiment de dissonance et de déséquilibre qu’elle implique (sentiment lui-même lié à la non-résolution tonale qui crée angoisse et tension), s’est immiscée dans la musique de cinéma en lien direct avec l’étrange et le menaçant. Affinité éloquemment confirmée par la Musique d’Accompagnement pour une Scène de Film de Schoenberg lui-même (1930) dont les trois parties sont intitulées Danger Menaçant, Peur, et Catastrophe… N’oublions pas une autre figure importante, le musicien européen d’avant-garde émigré aux USA Hanns Eisler, qui fut l’un des premiers disciples de Schoenberg en Europe et un des pionniers du dodécaphonisme avant de revenir à un langage plus traditionnel, en accord avec ses convictions marxistes. A Hollywood, il composa quelques musiques de films importants, dont Hangmen Also Die! (Les Bourreaux Meurent Aussi – 1943) de Fritz Lang, tout en continuant à écrire pour le concert et à être une des voix importantes de l’avant-garde par son enseignement et ses écrits. Son ouvrage Composing For Film, co-écrit avec Theodor Adorno, est un des premiers écrits théoriques complets sur le sujet et est resté longtemps une référence, malgré des vues idéologiquement très orientées. Sur la présence des musiciens européens d’avant-garde à Hollywood, on se reportera aux ouvrages très documentés d’Amaury du Closel et Kenneth Marcus mentionnés à la fin de cet article.
Enfin, comment ne pas mentionner l’apport considérable du génial Bernard Herrmann. Sa musique inclassable, qui n’a jamais recherché la modernité pour elle-même sans pour autant la fuir, tonale mais dans une conception très particulière de la tonalité, se signale surtout par sa folie orchestrale, sa démesure, son déséquilibre, l’originalité immédiatement perceptible d’un langage que l’on ne peut qualifier que d’« herrmannien ». Dès 1941, sa partition pour The Devil And Daniel Webster (Tous les Biens de la Terre) est d’un mordant qui ne doit déjà plus grand-chose au XIXème. Et s’il a parfois endossé les habits somptueux du romantisme (Vertigo), il a toujours su, quand il le fallait, faire preuve d’un esprit aventureux et indépendant et surtout de la personnalité la plus puissante et la plus originale qui se soit illustrée au cinéma. Avant d’aborder le cinéma, le jeune compositeur avait déjà une activité très intense comme animateur de la vie musicale new-yorkaise, défenseur de Charles Ives, membre du Groupe des jeunes compositeurs américains (avec Copland), fondateur d’un ensemble de musique de chambre et chef de l’orchestre de la radio CBS, à la tête duquel il mena une véritable politique en faveur des compositeurs américains contemporains. Devenu essentiellement musicien de cinéma, il apporte à ses partitions, somme toutes peu nombreuses pour un compositeur hollywoodien, la même rigueur et le même investissement créatif qu’à ses œuvres de concert, créant pour chacune un concept orchestral, un son différent. C’est donc très naturellement que les suites concues pour Psycho (Psychose – 1960) et d’autres films d’Hitchcock ont trouvé leur place au concert. Mais le processus existe aussi en sens inverse, puisqu’on trouve dans sa Sinfonietta pour cordes de 1936 le modèle de cette même musique de Psycho, en termes d’écriture, de climat et même d’idées thématiques.

On vient d’évoquer des grands noms, mais écoutons le travail d’un musicien beaucoup moins célébré comme Adolph Deutsch, dans The Maltese Falcon (Le Faucon Maltais – 1941) ou Northern Pursuit (Du Sang sur la Neige – 1943). On y trouve des séquences quasiment sans idée mélodique, des compositions de textures et de couleurs assez avancées harmoniquement, parfois plus proches de Hindemith que de R. Strauss (pour citer John Morgan).
Les musiciens mentionnés jusqu’ici sont essentiellement des (post)romantiques ou des néoclassiques, certains comme Honegger, Prokofiev ou Rózsa relevant souvent des deux catégories. A partir des années 50, des compositeurs d’une esthétique et d’une culture différentes font leur apparition, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis et vont, en quelques années, faire évoluer de façon radicale le style global de la musique pour l’image. Curieusement, c’est peut-être de Dimitri Tiomkin, compositeur très traditionnel de tant de ballades de western, que vint en 1951 le signe le plus net que les temps avaient décidément changé. Pour The Thing (La Chose d’un Autre Monde – 1951), le classique de science-fiction produit par Howard Hawks, il compose en effet une musique étonnamment moderne, atonale, bruitiste, agressive, pleine de stridences et de chocs percussifs, presque varèsienne. La même année, un inconnu nommé Alex North introduisait dans A Streetcar Named Desire (Un Tramway Nommé Désir – 1951) de Kazan un jazz à la limite de la tonalité, déstabilisant, grinçant, acide, qui allait frapper des musiciens aussi différents que Miles Davis et Jerry Goldsmith. Ce dernier a raconté le choc que fut cette musique et comment il avait alors réalisé que la musique de film avait définitivement changé. Mais ceci est une autre histoire…

Indications bibliographiques :
François Porcile, Alain Lacombe – Les Musiques du Cinéma Français, Bordas, 1995.
Amaury du Closel – Les Voix Étouffées du IIIème Reich, Actes Sud, 2005.
Kenneth H. Marcus – Schoenberg And Hollywood Modernism, Cambridge Univ. Press, 2016.
Brendan Carroll – The Last Prodigy: A Biography Of Erich W. Korngold, Amadeus Press, 1997.
Miklós Rózsa – A Double Life, The Baton press, 1982.
Steven C. Smith – A Heart At Fire’s Center: The Life And Music Of Bernard Herrmann, University of California Press, 2002.