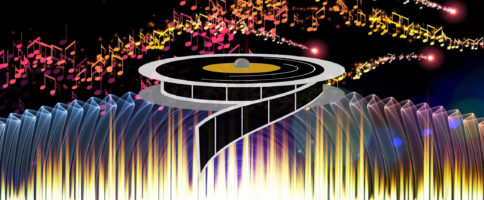Jetez-leur seulement en pâture un sujet de conversation apte à aiguillonner leur maniaquerie légendaire, et les geeks vous en feront d’interminables tartines. Qui, de John Buscema ou de Neal Adams, possède le coup de crayon le plus nerveux ? Qui sortirait vainqueur d’un combat singulier opposant Hulk à Superman ? Entre les Ewoks, irritantes peluches mono- expressives, et le batracien affublés de rastas Jar-Jar Binks, qui a le plus sérieusement égratigné le mythe Star Wars ? Aux yeux des simples mortels, une telle aptitude à disséquer les questions les plus frivoles relève, au mieux, d’inquiétantes pathologies névrotiques. Mais pour l’auteur de ces lignes, en plein désarroi, un peu de cette faconde hors norme aiderait grandement à débusquer jusqu’au plus infime dénominateur commun entre Elmer Bernstein, Jerry Goldsmith et David Raksin. Trois compositeurs autour desquels on ne se serait peut-être pas aventurés à improviser un triumvirat, avouons-le, s’ils n’avaient alimenté, à quelques semaines d’intervalle, la rubrique nécrologique des funestes mois de juillet et août 2004.
Bien sûr, leur présence sur un même piédestal semble pouvoir être aisément légitimée par leur statut conjoint de pointures de l’industrie hollywoodienne. Néanmoins, ce qui demeure vrai, sans conteste, pour Goldsmith et Bernstein s’avère un tantinet problématique dans le cas de Raksin, dont on a parfois le sentiment que les béophiles ne citent son patronyme que pour le plaisir sadique de l’écorcher. Bertrand Tavernier lui-même, pourvu d’une oreille pourtant moins fruste que celle du spectateur lambda, s’est déjà sérieusement demandé si l’auteur de l’immortel et somptueux Laura pouvait s’enorgueillir d’un autre titre de gloire. En vérité oui, homme de peu de foi, et procéder à l’énumération exhaustive des pépites en question deviendrait vite fastidieux, en plus d’échouer à disperser les brumes du semi-anonymat entourant le compositeur. Celui-ci ayant toujours manifesté beaucoup de goût pour l’exploration de contrées arides, parfois très éloignées de la mélodie fédératrice qui avait jadis les faveurs des studios, on comprendra mieux le pourquoi d’une carrière qui a creusé bien des sillons en marge de l’effervescence des grosses productions. Surtout, malgré de mémorables rencontres avec des cinéastes de la trempe de Vincente Minnelli, pour qui il s’est fendu du romantisme capiteux de The Bad And The Beautiful (Les Ensorcelés) ou William Wellman, il n’est parvenu avec aucun d’entre eux à nouer une aussi fructueuse collaboration que celle qui l’unissait à Otto Preminger. Collaboration qui, soit dit en passant, s’est recroquevillée comme peau de chagrin dans l’inconscient collectif pour ne plus renvoyer qu’à un seul film, Laura justement. C’était un trop sérieux handicap pour espérer atteindre les prestigieux sommets des binômes Hitchcock/Herrmann, Fellini/Rota, Burton/Elfman… ou encore, pour rebondir avec un bel à-propos sur le sujet qui nous préoccupe, Sturges/Bernstein et Schaffner/Goldsmith.
Aux antipodes de Raksin, qui fait presque figure de patriarche esseulé, les deux compositeurs suscités pourraient passer pour des frères de sang à plus d’un titre. L’un comme l’autre ont inauguré leur carrière cinématographique dans les années 50, ils ont contribué à nourrir les derniers feux d’un âge d’or avant d’assister à son inexorable déconfiture, puis ont frissonné à l’unisson des électrisants et tumultueux soubresauts des seventies. Dans les années 80, ils se sont encore engouffrés dans la même brèche, faisant flèche de tout bois avec une frénésie parfois hilare que leurs débuts ne laissaient guère augurer. Ceci posé, des trajectoires voisines ne sont pas obligatoirement synonymes de méthodologie identique. Chez Bernstein, le western qu’il a abondamment visité était surtout prétexte à éterniser une tradition, celle de l’americana outrancière dont Dimitri Tiomkin, grand maître du pot-au-feu symphonique, restera toujours le plus illustre (et décrié) émissaire. Malgré tout le brio déployé par Bernstein dans ce tonitruant exercice (si un thème peut prétendre à l’immortalité, c’est bien celui de The Magnificent Seven [Les Sept Mercenaires]), il n’est pas interdit de trouver autrement plus passionnante la démarche de Goldsmith, responsable, en particulier, d’un formidable tiercé formé par Rio Conchos, Hour Of The Gun (Sept Secondes en Enfer) et 100 Rifles (Les Cent Fusils). Là sont réunies une fougue et une invention timbrique tenant sans mal la dragée haute aux desperados de Cinecittà qui, massés derrière l’iconoclaste Morricone, criblaient alors de plomb les vieilles habitudes du western classique. Seul dans son coin, Raksin l’insoumis, jadis pourvoyeur de mélodies savamment sculptées pour des morceaux de l’envergure d’Across The Wide Missouri (Au-delà du Missouri), s’est laissé lui aussi séduire par ce démantèlement tous azimuts d’un mythe américain. Résultat, son aventure au sein des grands espaces a trouvé un superbe point final avec Invitation To A Gunfighter (Le Mercenaire de Minuit) et Will Penny (Will Penny, le Solitaire), deux partitions bourrées des trouvailles que le western à papa, de plus en plus perméable aux turpitudes du parent italien, s’était mis à réclamer à profusion.
Un autre trait saillant des geeks évoqués en exergue, c’est qu’ils sont intarissables dès lors que la discussion dévie sur les cross-overs impossibles et les paradoxes spatio-temporels (du genre : « les oreilles pointues des Vulcains, la tignasse frisottée des Morlocks et l’épiderme verdâtre des Zentradi : tous les attributs du glamour »). Mu par une même imagination débridée, ici matinée d’un soupçon de masochisme, le béophile concocterait toutes sortes de scénarios pour répondre à cette angoissante interrogation : à quelle sauce Hollywood aurait mangé nos trois gaillards s’ils avaient encore œuvré de nos jours ? Pareil débat n’est point propice à l’optimisme, tant les formules ultra-codifiées, qui s’ingénient à l’heure actuelle à malaxer avec rudesse nos tympans, ont fait tomber sous leur règne despotique d’indénombrables compositeurs, et pas des moindres. A y regarder de plus près, pourtant, Bernstein et surtout Goldsmith étaient coutumiers de l’utilisation reine de l’électronique, le premier grâce aux ondes Martenot dont il a truffé presque tous les genres abordés au fil de son œuvre, le second en délivrant une impressionnante quantité de scores synthético-symphoniques. Mais les exécutifs hollywoodiens, jamais rassasiés de sound design plus-basique-tu-trépasses, et forcément très échaudés par la patine dangereusement sophistiquée des Heavy Metal (Métal Hurlant) et autres Total Recall, auraient sans doute contraint les infortunés Elmer et Jerry à émasculer, ou tout au moins abâtardir leur propre style. Sans la protection de poids d’un Steven Spielberg, ou la position miraculeusement privilégiée de Michael Giacchino, on a peine à imaginer comment les héros d’autrefois s’y seraient pris pour faire entendre, au milieu du marasme ambiant, leurs voix si particulières.
L’herbe aurait-elle été plus verte ailleurs ? Raksin, qui ne convoitait pas vraiment le titre de prince du blockbuster, n’y aurait certainement pas réfléchi à deux fois. La série B, de son propre aveu, était le stimulant idéal pour les tempéraments créatifs, tant par son manque de moyens incitant à la débrouillardise que par la paix royale qu’on lui fichait d’ordinaire. Au cours d’un entretien réalisé après la fin de sa carrière pour le grand écran (et accordé à… Elmer Bernstein), Raksin a ainsi fait l’éloge de ces films sans le sou et pour la plupart obscurs, plaçant au rang de ses favoris le très oublié What’s The Matter With Helen? : rien de plus qu’un ersatz de What Ever Happened To Baby Jane? (Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?), comme le succès du monument outrancier de Robert Aldrich en a vu fleurir pléthore, mais qui donnait les coudées franches à une roborative sécheresse musicale. La petite lucarne a cependant été le dernier refuge de celui qui chérissait plus que tout sa liberté artistique, et proclamer qu’il l’aurait quittée pour se mesurer à la musique de film des années 2000, cette créature contrefaite si peu semblable à celle qu’il avait connue autrefois, représente un pas qu’il parait bien téméraire de franchir.
Bernstein, de son côté, n’a su s’ouvrir aucune issue de secours. A la fin de sa vie, les occasions d’injecter un peu de sang frais à son art passablement momifié par les ans s’étaient faites clairsemées. Hollywood ne le voyait plus qu’avec le respect rigide qu’inspirent de poussiéreuses pièces de musée, ce qui avait certes l’avantage de lui garantir un minimum d’égards, mais le condamnait par là même à bégayer sans fin ses propres recettes (tout jouissif qu’il est, le score de la bordélique adaptation de Wild Wild West ne parvient hélas pas à éviter l’ornière de l’auto-citation stérile). Même si indéniablement mieux loti, Goldsmith n’est pas passé au travers des mailles du filet. Mis au banc par la faute d’une post-production à rebondissements, son ultime opus majeur, Timeline (Prisonniers du Temps), a vu lui succéder la partition nettement moins impliquée d’un Brian Tyler encore néophyte, mais déjà adepte du tir de barrage en tous sens. Alors qu’il s’apprêtait à quitter définitivement la scène de ses exploits, le génial compositeur fut bien obligé de se rendre à l’évidence : le royaume du blockbuster, sur lequel il avait régné naguère avec son incomparable prestance, ne comptait plus lui faire les yeux doux. Eût-il survécu à la maladie qui l’a emporté, il y a gros à parier que Goldsmith se serait retrouvé à jouer les utilités sur les énièmes suites/préquelles/reboots de ses anciens hits (First Blood [Rambo], Alien, Planet Of The Apes [La Planète des Singes], Basic Instinct), contraint et forcé par des producteurs aux tympans atrophiés à n’en produire que de pâles fac-similés. Encore qu’à bien y penser, on aurait été curieux, au milieu de cette cohorte d’aberrations sonores, de le voir renouer avec l’univers de Star Trek, où s’est favorablement distingué (à une échelle plus modeste, certes) un Michael Giacchino investi des pleins pouvoirs.
Après tant de vitriol jeté contre les mutations douloureuses du petit univers de la musique de film, votre serviteur aura bien du mal à vous convaincre que ses divagations uchroniques n’avaient aucunement pour but de dévider une nouvelle fois le célèbre refrain « c’était mieux avant ». Il serait donc plus sage d’arrêter là le jeu de massacre, et de laisser les morts où ils reposent. Le son de Hollywood a surmonté la perte de ses pères fondateurs (Steiner, Korngold, Waxman, Alfred Newman) et de leurs enfants brillants, parfois très indisciplinés (Rozsa, Herrmann), de ses hardis francs-tireurs (North, Fielding) et de dizaines d’autres gens talentueux que la postérité n’a pas jugé bon d’accueillir en son sein. Ingratitude crasse ? Syndrome de la mémoire courte ? Le monde du cinéma ne peut tout simplement pas se payer le luxe d’arrêter de tourner, ne fût-ce qu’un bref instant, afin de pleurer ses hérauts disparus. Et même si l’heure des compositeurs caméléons, capables d’exhiber toutes les couleurs musicales possibles, appartient au passé, il n’est pas dit qu’un jour, sous des cieux moins orageux, la profession n’enfantera pas un nouveau diablotin aux mille visages. Parmi lesquels se profileraient, resplendissants, telle l’empreinte d’un héritage crânement assumé, ceux de David Raksin, d’Elmer Bernstein et de Jerry Goldsmith.