 MARTIN / POLLOCK (1976 / 2000)
MARTIN / POLLOCK (1976 / 2000)
MARTIN / POLLOCK
Compositeur : Donald Rubinstein
Durée : 59:21 | 36 pistes
Éditeur : Perseverance Records
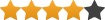
On peut tirer à boulets rouges sur les excès de la société de consommation, nourrir une méfiance larvée à l’encontre de tout ce qui incarne une autorité quelconque, égratigner férocement les pulsions autodestructrices du genre humain et faire néanmoins preuve d’un conservatisme frileux dans ses goûts musicaux : telle fut l’étrange impression laissée par George Romero lorsqu’il délivra en 1978 son propre montage de Dawn Of The Dead (Zombie), où l’explosive partition des Goblin s’avérait réduite à la portion congrue alors que Dario Argento, grand ordonnateur de la version européenne, n’avait pas hésité à s’enivrer jusqu’au point de rupture de ce cocktail outrageusement rock’n’roll. Un an avant de lâcher ses meutes de morts-vivants dans les entrailles de l’immense supermarché de Monroeville, Romero s’était pourtant autorisé toutes les audaces sonores en encourageant le discret Donald Rubinstein à contaminer Martin de sa fièvre créatrice. Les envolées gothiques plus conventionnelles d’un James Bernard n’auraient de toute façon guère convenu à un film si audacieux, qui revisite le mythe essoré du vampire sous un angle novateur et nihiliste. Martin, qui promène un insondable mal-être dans les rues blêmes de Braddock, a l’intime conviction d’être un Fils de la Nuit… et agit en conséquence. Cauchemardesque réalité ou fantasme morbide issu d’un esprit tourmenté ? Maître de ses effets, Romero se garde scrupuleusement de trancher et alimente le doute de bien des manières, dont la partition convulsive de Donald Rubinstein n’est pas la moins troublante.
The Calling, aria envoûtante, aurait pourtant pu donner le la. Cette mélopée féminine, supportée par les inflexions funèbres du piano et de la flûte, semblait être le prélude idéal à une musique au minimalisme sobre et lancinant. Mais nos confortables a priori ont à peine eu le temps de se dessiner que Train Attack, à grand renfort de violons dissonants et de saxophone au phrasé déjanté, les fait voler en éclats. A l’instar du film blafard qui l’a manifestement beaucoup inspiré, Rubinstein virevolte d’un extrême à un autre et prend un plaisir narquois à se jouer de nos attentes. A cet égard, le Main Title n’est pas épargné par un tel éclectisme, passant sans ambages des atours délicatement jazzy dont le pare Martin Goes To The City aux étranges coassements électroniques de Phased. Le tracklisting lui-même tente malicieusement de brouiller les cartes : par son seul intitulé, Antique Chase With Villagers promet la résurgence d’un fantastique désuet, où des villageois fous furieux, brandissant des torches en une procession nocturne, poursuivent le monstre de leur haine superstitieuse… et ce sont très exactement les images que Romero nous livre en cet instant, allant même jusqu’à abandonner la couleur pour un noir et blanc nauséeux ! Mais le réalisateur, toujours aussi fermement résolu à ne pas nous livrer le récit clé en main, s’interdit de faire trop ouvertement pencher la balance en faveur d’un vampirisme traversant les siècles. Qui sait si les cordes incapables de s’accorder entre elles et les percussions disparates que fait alors éclater Rubinstein ne témoigneraient pas, en réalité, de la psyché bosselée d’un Martin s’escrimant à justifier sa folie homicide par les visions trompeuses d’un passé chimérique ?
Cela dit, même si George Romero observe les sanglantes pérégrinations de son héros d’un œil froid et scrutateur, il ne peut se résoudre à n’en faire qu’un monstre dépourvu d’âme. Entre deux agressions brutales (le hautbois sinistre de Crawling Sequence, la rythmique déglinguée de Garlic Chase, Halloween et son piano débordant de noirceur), uniques alternatives qu’il s’est trouvées à un quotidien morose et glacé, Martin réussit presque sans le vouloir à nouer des liens affectifs avec deux femmes en qui il croit reconnaître le désœuvrement qui n’en finit pas de le ronger. Le saxophone feutré de Back To Me, les mélodies lounge de Marie – Interlude et Fly By Night sont autant de bouffées d’air pur pour le cerveau malade et accablé de solitude de Martin, qui pressent en ces fugaces moments de paix quelle vie plus accorte pourrait être la sienne. Mais sa soif de sang décidément inextinguible prend le dessus lorsque ses «muses» l’abandonnent subitement, sa cousine quittant la Pennsylvanie tandis que la flûte et le piano de Christina Leaves dévident à l’unisson leurs notes mélancoliques, et l’épouse esseulée, dont il était devenu l’amant, se tailladant les veines dans sa baignoire. Macabre ironie du destin, c’est par cette mort dont Martin n’est nullement responsable que l’oncle Cuda, animé d’une foi brûlante dont on ne saura jamais si elle est celle d’un vaillant croisé du Christ ou d’un dément meurtrier, décide d’anéantir le mal qu’il sent tapi derrière le visage impassible de son neveu. S’ensuit un Exorcism fort peu orthodoxe, où les cordes, s’emballant en pizzicati sardoniques, n’évoquent guère la célébration triomphale des forces du Bien. Et l’ultime banderille impitoyablement plantée par Stake Land, qui reprend l’Hymne à la Joie de Beethoven sous la forme d’un carillon froid et sourd, achèvera de plonger le spectateur dans un malaise teinté d’effroi, le laissant incapable de décider si Romero lui a conté une histoire de vampire moderne, ponctué d’un happy end rédempteur, ou la chronique désespérée d’une folie abominablement humaine.
Mais l’audace n’est pas toujours récompensée à la hauteur de ses mérites. Si Martin a été, pour un Donald Rubinstein sans entraves, le terrain de jeu idéal pour ses expériences musicales à contre-courant, on ne peut en dire autant de Pollock, tourné plus de vingt ans après et source, cette fois-ci, de bien des frustrations. Rétrospectivement, toutefois, comment aurait-il pu en être autrement ? Le tempérament de franc-tireur du musicien ne pouvait que se heurter violemment à la sensibilité moins frondeuse d’Ed Harris qui, pour son premier essai derrière la caméra, cherchait surtout à faire œuvre d’un classicisme rigoureux. En fin de compte, c’est le plus malléable Jeff Beal qui obtint les faveurs de l’acteur-réalisateur et écrivit une partition dotée de soubassements thématiques plus ostensibles, à défaut de ruisseler d’inspiration. Un postulat aux antipodes de celui de Rubinstein, qui avait témérairement résolu de faire siens les préceptes artistiques de Jackson Pollock en jetant ses notes à la volée sur le papier à musique tout comme le grand chambellan de l’Action Painting éclaboussait jadis ses toiles de vastes mosaïques de couleurs. Le résultat, on n’a aucun mal à le concevoir, est pour le moins déstabilisant.
Plusieurs des instruments qui électrisaient Martin figurent à nouveau au pupitre, mais l’étrange squelette musical qu’ils avaient constitué pour le chef-d’œuvre de George Romero se révèle ici encore plus opaque, encore plus insaisissable. Là où les soubresauts sonores dévolus au vampire-qui-n’en-est-peut-être-pas-un s’imposaient, à leur manière tortueuse, comme la voix des troubles, des angoisses et des terribles impulsions d’un protagoniste à la frontière de l’autisme, Pollock s’échine, lui, à traduire autant que faire se peut la matière hétéroclite des travaux souvent moqués du peintre. D’où cette partition fragmentée, morcelée en blocs épars qui se cognent les uns contre les autres plutôt que de converser harmonieusement, sautant du jazz moelleux de Sketches For Pollock et Along Corridors à la contrebasse sépulcrale de Pollock Blue comme si pareille démarche allait de soi. Au milieu des gammes délicates au piano, des crissements de cordes et des percussions en pagaille (xylophone, batterie, boîte à rythme), des filets de voix diaphanes s’élèvent avec volupté, témoins, peut-être, de l’état de grâce d’un artiste à la plénitude de ses facultés. Mais le climat de douce quiétude en passe d’être instauré se voit rompu sans ménagement par le mystérieux Empty Heart, où ces mêmes vocalises semblent soudain se chevaucher comme par un curieux effet de dédoublement. Donald Rubinstein avait-il en tête d’esquisser ainsi l’hypothétique dualité entre un Pollock souverain dans son atelier et son alter ego plus vulnérable, à la merci de l’alcool qu’il ingurgitait en quantité ?
Ce ne sont malheureusement là qu’expectatives hasardeuses, que les choix tout autres du réalisateur ne nous permettront jamais d’éprouver à l’écran. Finalement, davantage encore que l’envoûtante partition de Martin, dont la précédente incursion en CD, chez le regretté éditeur Percepto, reste relativement aisée à dénicher, la musique rejetée de Pollock est le plus séduisant argument en faveur de l’album concocté par Perseverance. Lequel nécessite toutefois de passer outre la hideur criarde de sa pochette pour offrir aux imaginations fertiles l’occasion de monter de bric et de broc le film, sans aucun doute chaotique et fiévreux, que Rubinstein avait fantasmé en marge de celui, plus convenu et discipliné, d’Ed Harris.











