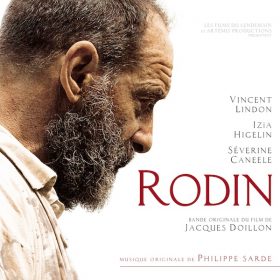LE LOCATAIRE (1976)
Réalisateur : Roman Polanski
Compositeur : Philippe Sarde
Séquence décryptée : Apparitions (1:25:29 – 1:29:05)
Éditeur : Universal Music France
Quelle fut-elle, au juste, la goutte d’eau traitresse qui fit déborder le vase ? Peut-être une œillade inquisitrice de trop, glissée à travers les rideaux d’une fenêtre ou dans l’entrebâillement d’une porte. Peut-être encore les promesses de Jugement dernier qui sanctionnaient le moindre embryon de tapage nocturne. A moins qu’il ne se fut tout bêtement agi de l’obstination du patron de café à servir à Trelkovsky un paquet de Marlboro, à la place des Gitanes qu’il demandait… Nul ne sait. Par contre, si l’on ignore comment, l’instant fatidique où le petit polonais perdit définitivement pied n’occasionne guère d’hésitation. Philippe Sarde, compositeur de première force, mais aussi homme de cinéma à la sensibilité exacerbée, ne s’y est pas trompé. La cafardeuse banalité du décor aurait pu endormir sa vigilance. Au lieu de quoi, les lieux d’aisance exigus où s’est cloitré notre malheureux personnage sont devenus, pour la gourmandise avant-gardiste de Sarde, un stupéfiant défouloir.
Quelque chose cloche forcément, ceci dit, dans ces gogues décrépits. Les murs tapissés de hiéroglyphes, que Trelkovsky parcourt l’œil rond, peuvent difficilement n’être qu’un caprice décoratif du propriétaire. Déjà, la musique, roulée au creux de sombres encoignures, n’attend que de nous sauter à la gorge. Les ondoiements cristallins de l’harmonica de verre, ce singulier instrument dont Sarde dit que l’idée de l’employer lui vint fort inopinément durant son dîner de rencontre avec Roman Polanski, donnent le sentiment d’enfler en cercles concentriques qui, l’un après l’autre, molestent les angles et les perspectives autant que s’y affairent des courtes focales de guingois. Ballotté au cœur de ce vortex visuel et sonore, Trelkovsky ne sait plus à quel saint se vouer. Car, depuis la fenêtre encastrée dans une paroi des toilettes, il vient de surprendre le regard scrutateur d’un homme qui lui est plus familier que n’importe qui d’autre en ce monde blafard : lui-même.
A quoi peut-on encore se fier, quand tous vos sens disjonctent et complotent contre vous ? Trelkovsky en reste coi, préférant se calfeutrer dans un appartement devenu peu à peu l’excroissance, noire et difforme, de ses propres névroses. Pas une fois ne s’élèvera son thème, un solo de clarinette chétif qui ne soulevait de toute façon pas davantage de bruit, dans ce cauchemar délétère de briques suintantes et de vitres sales, qu’un sanglot peureusement étouffé. Eût-elle essayé de sortir de son mutisme, cette timide rengaine, qu’un terrifiant cluster, emmailloté de cordes plus froides et plus acérées qu’un rasoir, l’aurait aussitôt écrasé de toute sa masse. La faute à Trelkovsky, que le rectangle livide de sa fenêtre a envoûté une fois encore. La silhouette qu’il dévore du regard, de l’autre côté de la cour, appartient à une femme, couverte de bandelettes à la façon d’une momie. L’effeuillage macabre qui s’ensuit, au son grinçant de la litanie de Sarde, révèle des yeux noirs et malgré tout brillants, et un sourire narquois… voire — horreur suprême ! — aguicheur.
Cette femme, c’est Simone Choule. La suicidée. L’ancienne locataire des lieux, dont le logement échut, telle une malédiction antique, à notre infortuné bonhomme. Celle dont tous les résidents voudraient le voir adopter les petites manies et le train-train huilé. Machination tortueuse ou paranoïa mortifère, qu’importe à ce stade, qui marque d’un trait dur le point de non-retour. De jeux de miroir en hallucinations véristes, d’une chausse-trape enchâssée dans le quotidien grisâtre à une autre, Roman Polanski, à l’heure de conclure après Repulsion et Rosemary’s Baby sa trilogie dite « des appartements », n’accorde aucune grâce à son héros en perdition. Sarde n’est pas beaucoup plus enclin à la miséricorde, lui qui a clairement puisé dans le sac à malice des chantres de la musique contemporaine (Ligeti, Xenakis et consorts), convulsée en d’incessantes mutations depuis les années 50, avant de jeter un Paris exsangue aux frontières de l’irréel. Dans cette réalité-là, atroce miniature kafkaïenne, on se terre chez soi comme au fond d’une tranchée en état de siège, et l’on ne darde un œil au-delà de son étroit pourtour que pour… quoi ? Epier avidement son prochain, bien sûr. Et se repaître des reflets de l’âme qu’un bout de verre renverra peut-être.