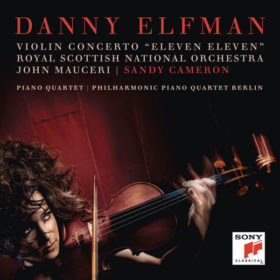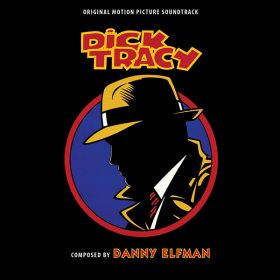EDWARD SCISSORHANDS (1990)
Réalisateur : Tim Burton
Compositeur : Danny Elfman
Séquence décryptée : The Cookie Factory (0:32:07 – 0:34:02)
Éditeur : Intrada
Laisser la musique raconter une scène, sans recourir aux dialogues, est une audace assez rare, d’autant plus dans le cinéma hollywoodien. Producteurs et réalisateurs, par orgueil sans doute, n’aiment souvent rien tant que nous mener par le bout du nez, fiers de démontrer ainsi l’étendue de leur art, qui consiste pour eux à savoir quels bouton presser pour faire sortir du rire, des larmes, de la pitié, de la colère. Nombre de cinéastes sont ainsi célébrés pour leur qualités de storytellers, entre les mains expertes desquels nous nous remettons, impatients et sûrs du plaisir à venir, n’ayant rien d’autre à faire que regarder vers où le doigt du ténor pointe. Mais prendre le risque d’inviter plutôt que de ravir est dangereux : on ne peut être sûr que tout le monde va saisir. Le jeu en vaut pourtant la chandelle. Pour le spectateur qui a trouvé son chemin dans les images, la récompense est incomparable : celle d’une émotion décuplée par le plaisir d’être le complice du cinéaste, et non plus son cobaye consentant.
Mélange parfait de maîtrise et de sensibilité sincère, la musique d’Edward Scissorhands, peut-être le plus beau film de son cinéaste, demeure la partition la plus emblématique de la veine féérique de Danny Elfman. Tim Burton et son musicien travaillent alors en parfaite harmonie, comme l’illustre discrètement une scène pourtant essentielle du film, celle de la fabrique de biscuits. Souvenir ramené à la conscience d’Edward par la vision hypnotique d’un ouvre-boîte électrique, elle nous raconte rien moins que sa naissance, ou du moins, le moment où son inventeur eut l’idée de le créer. Moment fondamental, donc, qui va nous être raconté sans recourir au dialogue, ou plutôt par la seule grâce de celui que la musique entretient avec les images.
Invitée à se déployer sur une scénographie précise, établie en fonction d’un décor concentrant à lui seul tout l’imaginaire burtonien, la musique de Danny Elfman déroule pour nous le paysage intérieur de l’inventeur, jusqu’au moment essentiel de son inspiration créative. Tout commence avec une marche vigoureuse, mi-comique, mi-menaçante. Une image musicale parfaite de la fabrique de biscuits : le laboratoire stylisé et inquiétant, comme dans un film de James Whale, d’un savant excentrique… mais destiné à fabriquer de bien traditionnels et appétissants cookies, grâce au travail parfaitement synchronisé de robots discrètement anthropomorphes. Entraînante mais lourde, c’est une musique binaire, au rythme martelé, efficace mais presque sans grâce, comme les machines. Sa progression est d’ailleurs calée sur les pas vigoureux, ponctués par un tambour, du robot faisant avancer le tapis roulant. Nous sommes à l’unisson de ce monde parfaitement harmonieux, quoique totalement aliéné à sa tâche. A la fois pour permettre à la musique de s’installer, et pour nous faire admirer la cohérence du travail sur le décor, la confection des biscuits nous est montrée en un plan-séquence. Il n’y a donc aucune place, ni dans la partition, ni dans la mise en scène, pour un pas de côté.
Une coupe permet à Burton de préparer le plan suivant, l’entrée en scène du savant (Vincent Price), sans avoir à refaire dans l’autre sens le traveling de son plan séquence. Un plan d’ensemble, nous permettant d’apprécier la coordination des machines, dont chacune, malgré son apparence anthropomorphe, ne constitue qu’un rouage, indispensable, mais remplaçable. Il y a pourtant une âme derrière ces machines. Comme dans les vrais contes de fée, l’image nous le montre littéralement : l’inventeur apparaît de derrière un gros réservoir. Elfman choisit de traduire l’idée tout aussi littéralement dans la musique : à cette apparition correspond celle des voix humaines dans la partition. La rythmique se fait moins marquée, bien qu’elle reste présente derrière des vents s’envolant avec liberté. A l’image, le savant esquisse une petite danse, qui semble suggérée aussi bien par le rythme de sa chaîne de biscuits que par la musique elle-même. Elfman nous fait suivre, en fait, les pensées vagabondes et joyeuses du personnage.
Maintenant qu’une altérité humaine est présente, la mise en scène peut s’organiser en champ/contre-champ, alternant regard du savant et plans sur les machines. Mais il ne regarde pas ce qu’elles font. Il regarde leurs visages suggérés, décoration inutile, d’ailleurs, à leur emploi. Nous nous rapprochons du bout de la chaîne, la musique ralentit, pour nous faire pressentir l’imminence d’une conclusion. Mais la rythmique couplée au pas du tapis roulant est toujours présente. Elle ne s’arrête que lorsque l’inventeur s’empare d’un biscuit. Pour contrôler la qualité de son produit ? En un cadrage parfait, révélé par un léger mouvement de caméra, Burton nous fait comprendre de quel moment précieux nous sommes témoins, en superposant le biscuit en forme de cœur à un robot au bras terminés par des couteaux. L’inventeur vient d’avoir une inspiration. Elfman nous fait ressentir cette étincelle de génie sans emphase. Pas d’eurêka triomphal, au contraire : les cuivres mécaniques et les coups de tambour se sont tus, remplacés par des clochettes et des vents entendus, par contraste, presque comme des murmures. Les voix, de retour, sont cette fois associées à l’image de la machine. Et l’on comprend le projet fou de l’inventeur : lui transmettre un peu de son âme. Elle a même déjà, dans son imagination, sa voix propre : Elfman conclut la scène en faisant chanter à son chœur, presque avec hésitation, le thème associé à Edward. Assister à la naissance d’une âme humaine est sans doute un privilège rare pour un spectateur. Encore plus rare, sans doute, le talent nécessaire à un compositeur pour en faire entendre la musique. Pourtant, en 1990, Danny Elfman, génial musicien, transporté par les images de Tim Burton, son frère de cinéma, parvenait à ce miracle.